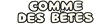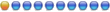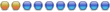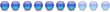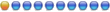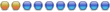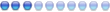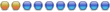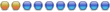Bonjour à tous,
Le manque de communication sur le volume Spirou et Fantasio 1946-1950 a suscité de nombreuses interrogations, hypothèses parfois amusantes et même des insultes. J’espère pouvoir apporter des informations claires : je sors tout juste des trois années passées à travailler sur ce titre. J'avais commencé à rédiger des messages pour apporter quelques réponses, j'attendais d'être un peu plus reposé après ce marathon pour en parler.
J’ai dirigé ce volume, réalisé la restauration du trait, co-réalisé la mise en couleur avec une petite équipe, et écrit le dossier, le tout sous la supervision d’Isabelle Franquin et Fred Jannin, dont l’aide à chaque étape et le soutien a été extraordinaire.
Je vois qu’un des grands malentendus concerne le contenu de l’ouvrage lui-même, voire même son statut ou sa raison d’être. Je vais donc commencer par ça. Pour résumer le propos qui suit : ce livre présente une version bien différente des histoires présentées dans l’ancienne intégrale, il s’agit donc de deux livres complètement distincts.
De plus, ce volume présente une formule très différente de la majorité des intégrales Dupuis, puisqu’il s’agit avant tout d’un travail inédit de restauration et de mise en couleur. La plus-value des intégrales habituelles vient de la qualité des dossiers, de l’iconographie apportée en plus, mais non du traitement des planches des albums : dans la très grande majorité des cas, il s’agit de compilations reprenant le matériel exploité depuis plusieurs années. Il s’agit donc d’une démarche bien distincte ici.
Pourquoi une restauration du trait ?
Il n’y a pas lieu de s’en étonner : une très grande majorité des œuvres anciennes sont rééditées depuis la nuit des temps avec une qualité de reproduction du trait médiocre, qui ne rend pas justice au dessin de l’auteur. Les planches anciennes de Carl Barks présentent plein de traits effacés, comme celles de Tezuka ou Umezu, ou encore celles de Morris – dont les rééditions de Lucky Luke, encore aujourd’hui, présentent d’ailleurs des pages entières décalquées par Léonardo.
Au passage, j’ai vu que le cas des interventions de Léonardo et/ou du studio graphique de Dupuis sur les planches de Franquin était évoqué ici ; elles sont en réalité plutôt mineures dans le cas de Franquin et ne concernent que certaines cases ou des détails précis, comme le lettrage. En revanche, l’analyse des planches originales, comparées avec leur reproduction dans les nombreuses éditions qu’elles ont connues, permet de tirer une conclusion simple : les films d’impression utilisés pour les 200 premières planches de Spirou et Fantasio réalisés par Franquin sont médiocres, sans surprise, et ce depuis les premières éditions en album. Globalement, toutes les rééditions ont réutilisé le matériel conçu pour ces premières éditions, qui présentait d’emblée de nombreux défauts. Et le massacre n’a fait qu’empirer, de réédition en réédition. La pire version à mon sens étant celle qui est encore commercialisée actuellement, et qui est exploitée dans l’intégrale de 2006.
Le trait de Franquin est abimé à plusieurs titres.
1) Tout d’abord, il y a le fait que le matériel utilisé jusqu’à aujourd’hui, se base sur celui qui a été établi lors des premières éditions. Or, pour les histoires les plus anciennes, le trait était reproduit au moyen d’une gravure de mauvaise qualité, épaississant le trait, faisant perdre des détails, ou échouant à reproduire la finesse du trait de Franquin.
Voici plusieurs ex. avec, en haut, un exemple du noir et blanc utilisé pour toutes les éditions de « La maison préfabriquée », avec son épaisseur due aux procédés industriels de reproduction de l’époque, et, en bas, la restauration que j’ai réalisé cette année à partir de la planche originale.




2) Autre aspect de la détérioration du trait original de Franquin : à l’époque, les imprimeurs avaient conscience de l’impossibilité de reproduire certains traits trop fins. Or, Franquin a un encrage d’une grande finesse par endroits. Pour éviter que les lignes trop fines n’apparaissent pas, les imprimeurs repassaient dessus à la main. Parfois, ils ajoutaient là où Franquin n’en avait pas mis, comme pour compenser une perte générale de détails. Plusieurs endroits des planches comportent donc des ajouts discrets des imprimeurs, qui n’ont en rien l’élégance du trait de Franquin.
C’est le cas de la bouche de Spirou dans cette case tirée du Ring, lourdement soulignée par les travailleurs de chez Dupuis. Avec, en dessous, la version restaurée depuis l’original.


Autre exemple de ces ajouts, dans ce détail d’une case de L’Héritage, les lignes de mouvement accompagnant les notes de piano, très légères dans l’original de Franquin et vouées à ne pas passer la reproduction, ont été complétées avec un trait plus ferme (et maladroit) par l’imprimeur-éditeur, et certaines ont tout simplement été ajoutées sans raison. Cela peut sembler être du micro-détail, mais l’omniprésence de cette pratique finit par déformer fortement le trait de Franquin. Tous ces ajouts patauds, qui ont eu lieu dès la première parution dans le Journal de Spirou, disparaissent dans la version restaurée, réalisée depuis les originaux. En haut, l'original, en bas, la version avec les ajouts des travailleurs de chez Dupuis en circulation depuis la première édition.


3) Un cas particulier, que l’on retrouve surtout dans les histoires de l’album 4 aventures… : les hauts de tête coupés.
Tout le monde ici le sait, les planches paraissaient simultanément en français dans le Journal de Spirou et en néerlandais dans Robbedoes. Or, pour produire cette version flamande, le studio graphique de l’éditeur collait le lettrage flamand à même les planches de Franquin, et réalisait aussi des modifications à même ces originaux.
Cela abimait pour de bon l’original, certes…mais on pourrait penser que les films réalisés pour la version du journal étaient, eux, saufs, et que l’éditeur pouvait s’en servir pour les albums. Eh bien non. Pour plusieurs raisons laborieuses à expliquer, pour l’album 4 aventures de Spirou et Fantasio, l’éditeur a dû réaliser de nouveaux films…à partir d’originaux abimés par le lettrage néerlandais. Il a donc fallu « cacher » ces rustines néerlandaises…sans pouvoir réparer tous les endroits de l’original qu’elles avaient massacrés. Régulièrement, les bulles de Franquin étant recouvertes de collages en néerlandais, tout ce qui était dans ces bulles et autour des bulles a du être redessiné pour la version album, ou effacé.
C’est le cas du haut des têtes des personnages, qui étaient souvent dans les bulles, et qui sont très souvent effacés.
Voici un exemple tiré de Spirou chez les Pygmées.

4) Il faudrait ajouter le cas du lettrage. Le lettrage a très souvent souffert de la reproduction, et du fait qu’il était reproduit sur un film séparé du film du trait, ainsi que des corrections orthographiques et grammaticales. Le lettrage d’origine était présent sur de nombreux originaux, et quand ce n’était pas le cas, il a parfois fallu repartir du Journal de Spirou pour reconstituer les mots d’origine, altérés au fur et à mesure des éditions.
Concernant la restauration depuis les originaux : j’ai en effet eu la chance de pouvoir repartir de ces planches originales pour restaurer le trait de Franquin. Malheureusement, les originaux ont été introuvables pour toutes les planches originales des histoires courtes comme Le pharmacien, La visite de Saint-Nicolas, etc (15 pages) : les films ayant également disparu, ces planches sont proposées dans ce volume dans des versions légèrement restaurées des parutions du journal.
Les originaux du Tank (15 pages), ainsi que 10 planches de Radar le robot et 10 planches de L’Héritage ont disparu, mais non leurs films d’impression. Je suis reparti de ceux-ci pour les restaurer, complétant leurs manques en me basant sur le journal.
Les 144 planches restantes ont été restaurées depuis les originaux, avec des contraintes de délais terribles. C’était un travail complexe et long. En effet, certains originaux sont, vous le savez, recouverts de peinture, car ils étaient utilisés par les imprimeurs pour faire des essais (là encore, c’est un sujet qu’il faudrait développer, très fréquemment l’objet de contre-sens). Enlever la peinture de ces originaux numériquement a été laborieux et délicat, mais a permis d’obtenir un trait qui n’avait jamais été reproduit correctement.

Voici un exemple, tiré de Radar le robot. A droite, le film utilisé dans les éditions en vente jusqu’à aujourd’hui, avec un trait effacé, tout comme c’est le cas depuis la première édition, et la version restaurée depuis les originaux (après avoir enlevé numériquement la peinture dont ils étaient recouverts).
J’espère avec ces exemples avoir répondu à certaines inquiétudes concernant la restauration du trait.
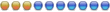

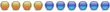
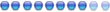

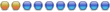
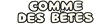
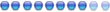
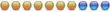
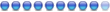

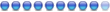

![vieux crouton [old]](./images/smilies/papy.gif)