Oui

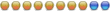
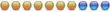
Philemon a écrit:Olaf Le Bou a écrit:marone222 a écrit:Autre sujet: la décision du Conseil d'état concernant Cnews, mais pas que...
Décision politique stupide et arbitraire...les chaînes vont devoir ficher et catégoriser leurs invités et chroniqueurs...une usine à gaz et un sacré coup à la liberté d'expression
"CNews, mais aussi les autres : comment l’Arcom va désormais surveiller les invités des chaînes de télévision"
https://www.leparisien.fr/culture-loisi ... KN3U3I.php
on t'as déjà connu plus soucieux du respect de la loi.
rien à voir avec la liberté d'expression pour le coup, il ne leur est pas reproché d'exprimer leurs idées, il leur est demandé de se conformer à la loi qui considère que pour bénéficier de la mise à disposition gratuite d'une fréquence sur le système de diffusion public, il faut respecter un minimum de pluralité.
Apparemment, LFI & EELV refusent de parler à CNews.
Donc la pluralité n'est pas possible.
Donc on supprime CNews ?
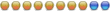
logan1973 a écrit:Philemon a écrit:Olaf Le Bou a écrit:marone222 a écrit:Autre sujet: la décision du Conseil d'état concernant Cnews, mais pas que...
Décision politique stupide et arbitraire...les chaînes vont devoir ficher et catégoriser leurs invités et chroniqueurs...une usine à gaz et un sacré coup à la liberté d'expression
"CNews, mais aussi les autres : comment l’Arcom va désormais surveiller les invités des chaînes de télévision"
https://www.leparisien.fr/culture-loisi ... KN3U3I.php
on t'as déjà connu plus soucieux du respect de la loi.
rien à voir avec la liberté d'expression pour le coup, il ne leur est pas reproché d'exprimer leurs idées, il leur est demandé de se conformer à la loi qui considère que pour bénéficier de la mise à disposition gratuite d'une fréquence sur le système de diffusion public, il faut respecter un minimum de pluralité.
Apparemment, LFI & EELV refusent de parler à CNews.
Donc la pluralité n'est pas possible.
Donc on supprime CNews ?
Pour la dernière campagne présidentielle CNews a été rappelée à l'ordre parce que le temps de parole accordé aux formations classées à gauche était systématiquement programmé entre minuit et 6 heures du matin. A quoi ça sert d'accepter d'aller parler à une chaine qui de toute façon a décidé de ne pas rapporter ta parole ?
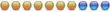


marone222 a écrit:Le pb n'est pas la représentativité politique par les politiques. Malgré quelques rappels à l'ordre, l'Arcom fait le job et les chaînes respectent les temps de parole.
Ce qui est nouveau, c'est la prise en compte des chroniqueurs et invités "non politiques "
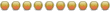
Olaf Le Bou a écrit:marone222 a écrit:Le pb n'est pas la représentativité politique par les politiques. Malgré quelques rappels à l'ordre, l'Arcom fait le job et les chaînes respectent les temps de parole.
Ce qui est nouveau, c'est la prise en compte des chroniqueurs et invités "non politiques "
Le problème, c'est qu'essayer de faire passer Zemmour ou De Villiers pour de simples chroniqueurs sans message politique, au bout d'un moment, c'est plus tenable. Encore une fois la question c'est : est-ce que C-News est un média d'information généraliste justifiant l'aide des pouvoirs publics, ou bien un média d'opinion qui devrait s'assumer comme tel et voler de ses propres ailes ?

marone222 a écrit:Olaf Le Bou a écrit:marone222 a écrit:Le pb n'est pas la représentativité politique par les politiques. Malgré quelques rappels à l'ordre, l'Arcom fait le job et les chaînes respectent les temps de parole.
Ce qui est nouveau, c'est la prise en compte des chroniqueurs et invités "non politiques "
Le problème, c'est qu'essayer de faire passer Zemmour ou De Villiers pour de simples chroniqueurs sans message politique, au bout d'un moment, c'est plus tenable. Encore une fois la question c'est : est-ce que C-News est un média d'information généraliste justifiant l'aide des pouvoirs publics, ou bien un média d'opinion qui devrait s'assumer comme tel et voler de ses propres ailes ?
Les chaînes privées ne bénéficient pas d'aides publiques.
La loi n'autirise pas de medias d'opinion audio visuels



toque a écrit:C'est déjà le cas.


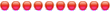

ubr84 a écrit:marone222 a écrit:Olaf Le Bou a écrit:marone222 a écrit:Le pb n'est pas la représentativité politique par les politiques. Malgré quelques rappels à l'ordre, l'Arcom fait le job et les chaînes respectent les temps de parole.
Ce qui est nouveau, c'est la prise en compte des chroniqueurs et invités "non politiques "
Le problème, c'est qu'essayer de faire passer Zemmour ou De Villiers pour de simples chroniqueurs sans message politique, au bout d'un moment, c'est plus tenable. Encore une fois la question c'est : est-ce que C-News est un média d'information généraliste justifiant l'aide des pouvoirs publics, ou bien un média d'opinion qui devrait s'assumer comme tel et voler de ses propres ailes ?
Les chaînes privées ne bénéficient pas d'aides publiques.
La loi n'autirise pas de medias d'opinion audio visuels
Ils disposent d'une fréquence de diffusion fournie par l'Etat.
Tout le sujet est là.
Et justement tout l'enjeu est que manifestement ils ne respectent pas l'obligation de pluralisme ce qui en fait un média d'opinion.
Tout le sujet est là aussi.
Donc la solution : on leur enlève leur fréquence fournie par l'Etat et ils se démerdent pour diffuser par leurs propres moyens leurs opinions.


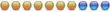
toque a écrit:Est-ce que ça existe ?
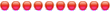
Philemon a écrit:Ca veut dire que tous les gens présents sur un plateau devront avoir un petit badge avec leur orientation politique inscrite ?
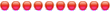
Mirdhynn a écrit:De toutes façons, plus aucun media n'est vraiment neutre (bon cnews, ça dépasse clairement les bornes en terme de neutralité, ne serait ce que paour les sujets d'actualité choisis)
Perso j'écoutais France inter en revenant du boulot, puis Vanhoenacker et Meurice sont arrivés. Au départ, ça respectait quand même une certaine neutralité, et puis ils sont complètement partis en vrille en faisant de la propagande de gauche, avec des invités de gauche etc... Ils ne s'en cachaient même plus. Je n'écoute plus FI depuis, pas besoin d'avoir un meeting électoral tous les jours dans les oreilles.
Ca explique bien cette décision, même des gens à priori pas identifiés comme des politiques font de la politique.
Maintenant, comment ils vont appliquer ça, je n'en ai aucune idée. Ils feraient mieux de mettre au pas les présentateurs et journalistes pour qu'ils gardent une neutralité, ça a bien fonctionné pendant des lustres, là tout le monde va payer pour quelques franc tireurs.
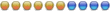
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités