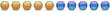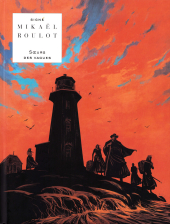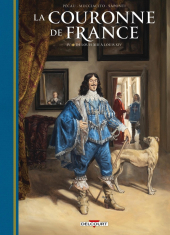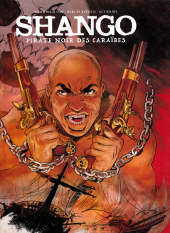Ces Indes Fourbes resteront comme un sommet dans la carrière des deux auteurs. Et je dis cela n’ayant jamais lu un Guarnido auparavant, et seulement les deux ou trois premiers tomes de Garulfo quand j’étais au collège. Donc on peut me croire.
La maîtrise à l’œuvre dans cette histoire est tout bonnement ahurissante. Ayrolles parvient à mêler respect du livre original, hommage au roman picaresque et utilisation de techniques narratives modernes au service d’une intrigue en chausse-trappe à l’ampleur insoupçonnable, alors même que le rêve d’Eldorado s’imprime dès la quatrième de couverture. Quant au texte, c’est une vertigineuse cascade de bons mots, de tournures savoureuses, de jeux avec le dessin - voir cette case hilarante peuplée de trognes torves et suspicieuses dans laquelle Pablos se félicite de retrouver la compagnie de bons chrétiens - qui épicent la lecture.
Guarnido, pour sa part, assure le grand spectacle avec son trait réaliste aux accents cartoon - tout en restant extrêmement soigné et d’une précision chirurgicale, on est bien d’accord - qui incite le lecteur à répondre à l’appel de l’aventure lancée par son scénariste sans y réfléchir à deux fois, participant activement au camouflage des intentions plus retorses du duo ainsi que celles de leur protagoniste.
Les auteurs ne se contentent effectivement pas de proposer une escapade épique, exotique et sans lendemains. Ce qu’ils désirent avant tout, c’est s’inscrire dans la lignée de leurs illustres modèles, Quevedo et Cervantes en tête. A cette fin, ils livrent un récit qui se déploie en trois actes que l’on pourrait trouver disjoints de prime abord tant leurs narrations et leurs ambitions thématiques sont différentes. Ce qui les rapproche néanmoins, c’est cette envie de traiter des diverses facettes d’un genre inventif et foisonnant, même les plus contradictoires, tout en mettant en évidence son héritage.
La première partie, la plus longue, est aussi la plus fidèle au roman picaresque d’antan. On s’attache à suivre Pablos, escroc à la petite semaine parti pour les Indes en quête de fortune, dans ses (més)aventures rocambolesques, rythmées par de menus triomphes et de grandes misères. Reprenant la narration à la première personne de l’œuvre d’origine, Ayrolles y ajoute une structure en flashback, une subtilité qui indique déjà l’entreprise de dépoussiérage des codes du genre et qui aura son importance plus tard.
Bien qu’étant une hypothétique suite immédiate d’El Buscón, c’est pourtant vers Cervantes que lorgne cet acte, toute ressemblance avec une œuvre ayant existé n’étant absolument pas fortuite, bien au contraire. Comme d’abord la trajectoire de Pablos, que la quête illusoire de l’Eldorado mènera au repentir, rappelant immanquablement la fantaisiste chasse aux géants d’Alonso Quichano qui le conduira sur les voies de la sagesse. Comment manquer encore le duo que forme don Diego, avatar du chevalier de la Mancha, la droiture incarnée, prêt à suivre n’importe quel reflet dans le miroir aux alouettes, et Pablos, Sancho Panza perché sur son âne, plus terre à terre que son maître mais non moins admiratif. Impossible non plus d’ignorer le morceau de bravoure graphique introduisant une violente rupture de ton qui souligne le tour épique des événements au moyen de techniques propres à la BD - narration muette, splash page grandiloquente, notamment. La dissonance cognitive que crée ce choix dans l’esprit du lecteur renvoie directement aux rêves éveillés d’un certain ingénieux hidalgo dont les illusions de grandeur confinent à la schizophrénie.
Tous ces éléments, de l’ordre de l’hommage, s’additionnent imperceptiblement en un récit fluide et enlevé, jamais à cours de rebondissements, évidents ou improbables, mais diffusent aussi le sentiment que le lecteur se trouve en territoire conquis, clairement borné et peuplé de visages familiers. Sentiment que fait exploser en beauté un deuxième acte qui révèle la trahison faite au genre… pour mieux le moderniser et l’honorer.
Car oui, le récit qu’a fait Pablos à l’alguazil sous nos yeux ébahis s’avère n’être qu’un tissu de mensonge au renfort d’une fourberie plus incommensurable encore que l’avidité qu’elle sert.
En entérinant la notion de narrateur non fiable, formulée pour la première fois dans la deuxième moitié du vingtième siècle, l’intrigue se détache des codes établis du roman picaresque et trace son sillon. Mais en y réfléchissant, qu’est-ce qu’un narrateur indigne de confiance, si ce n’est l’héritier conscient de Don Quichotte, dont la folie avait le pouvoir de tordre les perspectives et transformer la réalité. Utiliser cet artifice, ce n’est rien d’autre que remettre au goût du jour un genre qui a toujours eu l’expérimentation et l’innovation dans son ADN, tout en profitant de l’occasion pour déplacer les enjeux. La question n’est plus de savoir quelles leçons tirer des coups du sort s’abattant sur notre malheureux héros, mais de comprendre comment celui-ci a pris le contrôle de sa propre histoire.
Cependant, avant de répondre à cette brûlante interrogation, le scénario temporise l’action, prenant le temps de recomposer son univers après son principal retournement. La disparition impromptue de Pablos, jusque-là moteur de l’intrigue et point de vue unique orientant la narration, permet de saisir de manière plus objective les événements consécutifs à la mise au jour de sa duplicité - et même sa triplicité - en tirant sur tous les autres fils du récit. Ce procédé, très prisé de récits sériels modernes toujours plus tentaculaires - car permettant de tirer pleinement parti de leurs vastes fondations - consiste à déplacer temporairement le point de vue afin de prendre du recul sur les péripéties pour mieux éclairer leur enchaînement. Ce travail permet aussi d’accroître l’attente du lecteur en vue des révélations à venir.
Pour autant, il ne faut pas oublier un autre intérêt, et non des moindres, de cette partie, qui a à voir avec la structure narrative de ces Indes Fourbes: cet intermède sert de transition entre deux parties qui se répondent.
En effet, le troisième et dernier acte prend la forme d’une confession au lecteur à mettre en regard de la fable faite à l’alguazil. Patiemment, Pablos entreprend de dérouler la liste de ses mensonges, petits et grands, dans un inventaire qui pourrait presque être rébarbatif sans les lettres habiles d’Ayrolles. Dans le souci de remettre une bonne fois pour toute la BD dans les pas du roman, tout est passé au crible de la sordide vérité.
Car dans son Buscón, Quevedo peint une satire virulente de la société espagnole de son époque, en proie selon lui à une intarissable avidité et une corruption érigée en modèle. Là où le premier acte de la BD se concluait sur l’élévation morale de Pablos, la même que poursuivait Don Quichotte dans ses aventures, ce final reprend lui sa quête d’ascension sociale originelle en poussant la logique à son paroxysme. Le récit n’épargne plus son personnage, le montrant proxénète, traitre à cette communauté noire qui lui ouvrait ses portes, ou bien encore n’hésitant plus à employer le terme "nègre" quand il utilisait pudiquement celui d’"esclave marron" auparavant.
Pourtant, dans la longue litanie de ses infamies, un événement ressort intact, celui qui narre comment il est entré en possession du pendentif qui lui épargna la vie. C’est au prix de larmes sincères et d’empathie pour le destin tragique d’un peuple bafoué qu’il l’obtient, rappelant que Pablos, jadis enfant naïf au bon cœur, n’est que le produit de son environnement. Malgré ses actes odieux, jamais il ne sera un monstre.
Il ne peut en revanche être considéré comme une victime des aléas qui jalonnent son parcours. En réalisant ses désirs d’anoblissement social à défaut d’ennoblissement moral, il se fige dans en ce sous-titre de l’œuvre, ce vagabond exemplaire et miroir des filous. Le tour final que prend l’intrigue, une fois bouclé le développement de notre protagoniste n’est là non pas pour relancer une ultime fois le récit mais pour revenir aux intentions corrosives de l’auteur originel. Ou comme le dit Ayrolles mieux que moi, renoncer à la fourbe, se serait trahir le siècle.
Sous la surface d’un récit aux hémisphères en apparences déconnectés, les auteurs tissent une œuvre somme, pleine comme un œuf de références et clins d’œil à coup sûr impossibles à relever tous à la première lecture; cela sans se poser en fossoyeur du genre ni sacrifier leur histoire à la révérence appuyée et trop sage à force d’être respectueuse. L’audace et l’inventivité irriguant inlassablement la lecture m’auront enchanté 160 pages durant. Et la maîtrise évidente opérant à tous les niveaux aura fini de me persuader que nous tenons-là, oserai-je le dire, un chef d’œuvre.

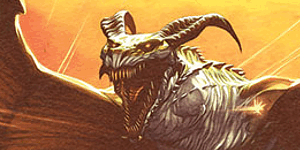
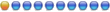
![Au revoir [:fantaroux:2]](./images/smilies/fantaroux.gif)
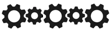

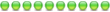
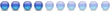
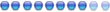
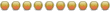

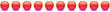
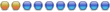
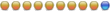
![Bravo [:flocon:2]](./images/smilies/flocon2.gif)