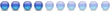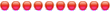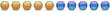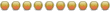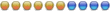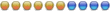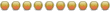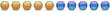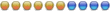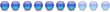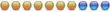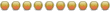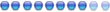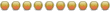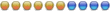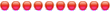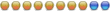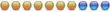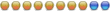bon, dans ce petit bouquin américano-italien, il y a une longue interview de Zezelj, menée par Pieranna Cavalchini à l'occasion de sa résidence d'artiste au musée de Boston.
je me suis amusé à traduire leurs propos

enjoy :
PC : Qu’est-ce qui vous a fait choisir le dessin comme principal moyen d’expression ? Vous avez suivi une école de peinture et vous en êtes pourtant tenu au dessin.
DZ : J’étais toujours en train de dessiner. Ça n’a pas été un choix, en tous cas pas un choix rationnel. C’est venu naturellement. Qu’est-ce qui définit réellement ce qui est dessin et ce qui est peinture ? Je pense que ce que je fais se situe entre les deux. Mon style, mon approche, mon dessin provient en définitive de mes études de peinture. Il n’y a pas de couleurs – si tant est que l’absence de couleurs fait d’une œuvre un dessin plutôt qu’une peinture – mais la manière dont j’utilise l’ombre et la lumière provient tout à fait de la peinture baroque, du clair-obscur. A la base, j’essaye d’appliquer les schémas, les mêmes principes que les peintres baroques utilisaient avec l’huile. Quand vous regardez les choses dans le clair-obscur, vous ne partez pas de la toile blanche, vous partez d’un ton moyen, généralement du sépia. Donc vous couvrez intégralement la surface d’une teinte ambrée, puis en enlevant de cette couleur, vous obtenez les tons clairs, et en en rajoutant les tons sombres. C’est un mode de pensée radicalement différent, uniquement en termes d’ombre et de lumière. Vous ne voyez pas de ligne, la ligne est exclue. Alors j’ai appliqué cette idée, forcer les contrastes jusqu’à n’avoir plus que du noir et du blanc.
PC : Quels sont les peintres que vous avez le plus étudié ?
DZ : J’ai beaucoup observé Le Caravage. Je pense que, plus que tout autre, il maitrisait vraiment cette approche par laquelle le sujet émerge de l’ombre vers la lumière. Sinon… j’aime beaucoup Velasquez. Et un autre peintre qui m’a toujours fasciné est Vermeer. D’un point de vue technique, il m’époustoufle. Je n’ai aucune idée de comment il a pu faire ça. C’est si sophistiqué. Les peintures en elles-mêmes sont très belles, mais si vous êtes du métier, vous pouvez voir qu’elles sont techniquement parfaites, de purs joyaux. Mais bien sur j’aime un tas d’autres peintres. J’ai fait des copies de Michel Ange, par exemple, et pas mal étudié Cézanne.
PC : Vous avez fait beaucoup de copies pendant vos études ?
DZ : Oui, c’est un très bon exercice. J’ai beaucoup appris ainsi. Bien sûr, après un certain point, vous ne faite que répéter les choses, mais c’est un bon moyen de comprendre comment ça marche, comment ça s’articule. Copier Caravage, Velasquez, etc, était intéressant, mais j’ai encore plus appris en dessinant des nus, en étudiant le corps humain.
PC : Comment faite vous pour transcrire les coups de pinceaux en utilisant de l’encre ?
DZ : J’ai toujours utilisé des pinceaux. Je n’aime pas le crayon, ça trace de fines lignes. Je n’utilise quasiment pas la ligne. Ça délimite les formes, mais ça n’atteint pas l’intérieur, là où se trouve le volume, la chair. Pour le dire autrement, soit vous voyez la ligne, soit vous voyez l’ombre et la lumière. Mais jamais les deux.
PC : Quelle importance ont les mots dans votre travail ?
DZ : Je trouve le dessin plus important que les mots, mais il y a un équilibre entre eux. Le dessin à la primauté, mais les mots sont importants. Ils ne suivent pas forcément le dessin, il peut y avoir une histoire dessinée, et une autre dans les mots. Cela crée un troisième plan, entre le dessin et les mots. C’est ce que je trouve le plus intéressant, cette façon de raconter des histoires.
PC : ce que vous décrivez est une forme de contrepoint. C’est très musical, très jazz ?
DZ : D’une certaine manière, en tant que méthode. Ce n’est pas forcément de l’improvisation, mais l’acte créateur est ce qui me tient vraiment à cœur, la manière de procéder. Je n’ai pas l’histoire complètement écrite, et des croquis pour toutes les pages, de manière à n’avoir plus qu’à m’assoir et dessiner toute l’histoire d’un jet. Je ne peux travailler comme ça. J’ai une idée de l’histoire, des personnages principaux, de comment ça va finir, parfois de certaines scènes, mais tout reste très ouvert. Pendant que je travaille, ces éléments ne cessent de se transformer jusqu’à se rejoindre pour faire un tout. Parfois je retravaille certaines planches une fois que l’histoire est finie, ou rajoute des scènes.
PC : Qu’est-ce qui vient en premier sur un nouveau projet ? Toujours le dessin ?
DZ : Je pense toujours en termes d’image, et souvent mes histoires viennent d’une image, d’un souvenir, d’une photo… mais c’est toujours visuel.
PC : Et pourtant les mots sont toujours très poétique, très beaux. Vous les soupesez soigneusement.
DZ : Quand j’écris, j’écris et réécris la même chose plusieurs fois, l’idée c’est d’éliminer tout mot qui n’est pas nécessaire. C’est comme ça que je procède, car je ne me vois pas comme un très bon écrivain. Alors j’essaye au maximum de réduire les mots. C’est similaire à mon approche des images : réduire les choses au strict nécessaire, au noir et blanc. Cela crée ainsi une connexion entre les mots et les images.
PC : En allant à l’essentiel, vous donnez à votre travail plus de force. Trouver ce point focal est ce qu’il y a de plus difficile, non ?
DZ : Oui, mais quand ça marche, ça ouvre de nouvelles dimensions. Car tout ce noir et tout ce blanc ne sont pas simplement du noir et du blanc : dans cet espace sombre, il y a en fait l’idée même de la lumière, comme en miroir. Il ne s’agit pas d’en enlever, il s’agit d’en mettre plus.
PC : Vous rythmez vos histoires de façon intéressante, très musicale.
DZ : je suis heureux que vous disiez cela. J’espère pouvoir capturer un peu de ce sens de la mesure, dans un média qui n’est pas forcément intéressé par le rythme. Dans le cinéma, c’est un élément important, en musique encore plus. Je trouve passionnante cette façon dont Thelonius Monk jouait : utiliser le silence comme un son. Il avait ces longues pauses quand il jouait. Utilisait le moins de notes possibles, au lieu d’emplir l’espace. C’était sa façon de penser et de travailler, réduire le nombre de note, et laisser le silence être une composante de sa musique. Il travaillait vraiment avec le temps, ne se contentait pas de lancer des notes dans l’espace, mais laissait cet espace respirer et les silences être aussi important que les notes.
PC : Avez-vous étudiez la peinture japonaise ? Je retrouve la qualité poétique des haïkus dans votre travail.
DZ : C’est un beau compliment, merci. Les haïkus ont un impact visuel fort, pas seulement à cause des images qu’ils véhiculent, mais aussi par la manière dont ils sont écrit.
PC : La calligraphie ?
DZ : L’écriture à une dimension visuelle importante dans ces poèmes, c’est un élément difficile à appréhender.
PC : Pouvez-vous parler un peu des thèmes visuels marquant de votre œuvre ? Certaines images récurrentes, le cirque, les boxers, le rhinocéros, les scènes urbaines…
DZ : Mes histoires sont souvent en relation avec la ville, les sensations qu’elle procure. Le rhinocéros est un symbole négatif, Quelque chose de dangereux, d’omniscient, quelque chose qui vous piétine, comme le système, la mauvaise part du système.
PC : Et la panthère ?
DZ : la liberté, la nature sauvage. C’est mythologique, ancien, l’idée de quelque chose d’indompté, d’inconnu. D’irrationnel. C’est la beauté de l’animal, son pouvoir de fascination. J’ai toujours trouvé les tigres et les panthères fascinants. Il y a toujours cette sensation de quelque chose au-delà de notre compréhension, que l’on ne peut appréhender rationnellement.
PC : et puis ils sont si beaux.
DZ : Exactement.
PC : D’autres animaux que vous utilisez ?
DZ : il y a souvent des éléphants, parfois même des éléphants volants.
PC : ça vient de votre période Marvel ?
DZ : Non, avant ça. J’ai toujours aimé Dumbo, mon Disney favori. Cette idée d’un animal, si lourd, si gros, pouvant s’envoler, c’est drôle, et c’est un symbole fort.
PC : Vous avez dit avoir beaucoup lu.
DZ : J’aime lire. Je n’ai pas de TV ni rien, si je ne dessine pas, je lis. Là, je lis les essais de Joseph Brodsky. J’aime ses poèmes, aussi. Octavio Paz est très important pour moi. Tout de lui m’intéresse. Bien sûr, il y a ces auteurs auxquels on peut toujours revenir – comme Dostoïevski – comme si c’était la première fois. J’aime Pier Paolo Pasolini, en tant qu’écrivain, pour moi il est d’abord un écrivain. Sa poésie est la part la plus fascinante de son œuvre. Ses films sont majeurs, mais sa poésie a été pour moi une grande découverte. Un mélange de quotidien, de trivialité, et d’éternité. La manière de dénicher la beauté classique dans le plus ordinaire des chiens errants de Naples. Un autre de mes auteurs favori est Bohumil Hrabal.
PC : Et le cinéma ?
DZ : Quand j’étais enfant, j’allais à la cinémathèque de Zagreb. Beaucoup de films anciens. Je voyais les expressionnistes allemands des années 20, les réalisateurs russes d’avant-garde. On pouvait y voir toutes sortes de choses, Buñuel, Buster Keaton, la plupart des Fassbinder, Herzog. Ainsi j’ai grandi en voyant beaucoup de bons trucs. Il y a beaucoup de similitudes, au niveau de la narration, entre le cinéma et le roman graphique.
PC : Quel est votre sentiment vis-à-vis de l’accessibilité ?
DZ : Eh bien, je crois que l’art ne devrait pas être séparé du reste du monde. Il doit en faire partie, et être accessible. En ce sens, le concept d’exposer en galerie est problématique. Ce qui me plait dans la bande dessinée, c’est que c’est facilement abordable, on peut l’imprimer, tout le monde peut la lire. Qu’on aime ou pas, il n’y a pas de contrainte pour y accéder. En même temps, cette forme d’art ne doit pas brider la créativité de l’auteur, ne doit pas être simplement soumise aux contraintes commerciales.
PC : Vous avez dit que ce qui était remarquable à propos du Krazy Cat de George Herriman, était la liberté que l’auteur a apporté au genre.
DZ : Herriman a transcendé un genre pourtant bien établi : le strip quotidien des journaux (et la page complète du supplément hebdomadaire). Il a créé quelque chose d’unique, très bizarre, très personnel, et très beau. Et c’est pourquoi aujourd’hui, c’est aussi frais et novateur que ce l’était à l’époque, et que ce sera toujours. Elles sont simplement intemporelles, ces petites histoires.
PC : Pensez-vous faire quelque chose de similaire, d’une certaine façon ?
DZ : Ce serait très prétentieux de dire ça. Je ne sais pas si ce que je fais aura encore du sens dans cinq ou dix ans, même pour moi. En fait, je pense qu’il est impossible de créer quelque chose, si vous partez avec l’idée que cela perdurera pour toujours.
PC : Car la vie est trop précaire ?
DZ : Oui, vous créez à cause d’un désir fort, de la nécessité d’exprimer quelque chose. Vous n’avez aucune idée de la qualité du résultat final, vous ne pouvez que faire de votre mieux. Essayer de mettre tout ce que vous savez et tout ce que vous ressentez, et de la meilleure façon. Ça ne veut pas dire que ce sera bon. La pire poésie est écrite avec les meilleures intentions.
PC : Pensez-vous aborder votre art avec un nouveau langage ?
DZ : Qu’il soit nouveau ou non, c’est un langage que je ne vois pas beaucoup ailleurs, mais ça ne veut pas dire que j’invente quoi que ce soit de très novateur.
PC : Oui, bon, tout a déjà été inventé, mais votre travail demeure clairement identifiable. Depuis les années 90, il a évolué, mais l’expression demeure la même. Pensez-vous avoir beaucoup changé avec les années ?
DZ : Je pense avoir changé la forme. C’est différent, mais le principe de narration à travers les images demeure le même. En travaillant, vous découvrez de nouvelles techniques, vous apprenez de nouvelles manières d’exprimer les choses. En ce sens, oui, j’ai changé. Mais l’intention et le désir de communiquer sont les mêmes. Cette évolution se fait par à-coups, jamais de façon linéaire. Parfois j’ai eu l’impression de m’être perdu, et puis c’est revenu.
PC : On avait évoqué l’influence de la photographie, vous m’aviez cité Robert Frank comme quelqu’un que vous admiriez. Quel est l’impact de la photographie sur votre travail ?
DZ : C’est un certain genre de photo, reportage ou documentaire, qui m’intéresse. Pas la photo où tout est bien ordonné, posé. Robert Frank est un auteur qui saisissait l’instant présent, le hasard, et pourtant on peut toujours reconnaitre son travail. C’est son œil qui est présent. Il est capable de capturer l’essence de la vie sur une seule image. La part la plus ordinaire, quotidienne, de la vie. Mais tout est là. Je pense que c’est le don de la photographie. C’est aussi ce qui me fascine chez Diane Arbus, car dans chacun de ses portraits, vous sentez comme l’essence de cette personne. Je ne sais pas comment ils arrivent à ça. Je ne suis pas sûr que le photographe lui-même sache exactement ce qu’il est en train de faire.
PC : Qu’est-ce que ce titre, Chiens errants, signifie ?
DZ : Le titre provient des mots à la fin de la dernière histoire :
I will keep searching and running like a stray dog. Les chiens errants, ça peut être n’importe quoi, des pensées qui vagabondent, des sentiments épars… une métaphore pour ce qui est perdu et qui rôde.
PC : Errance, cela implique le nomadisme. Pensez-vous être un nomade ?
DZ : Je pense ne pas avoir de « chez-moi ». Est-ce être un nomade ? Un lieu qui vous appartienne, et auquel vous appartenez, rien de cela pour moi en ce moment. Pas dans le monde physique. Je suis partagé entre mon désir de me fixer et mon sens de la liberté. C’est à la fois une malédiction et une bénédiction, ça me force à avoir un lieu imaginaire… un lieu bien chancelant, que le vent peut souffler à tout moment.
![joie intense [youpi]](./images/smilies/joieintense.gif)
![joie intense [youpi]](./images/smilies/joieintense.gif)
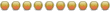
![joie intense [youpi]](./images/smilies/joieintense.gif)

![Au revoir [:fantaroux:2]](./images/smilies/fantaroux.gif)