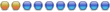
Rebecca Doppelmeyer a écrit:Je signale que je n'ai rien à voir dans cette discussion, il y a une erreur de citation
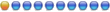
![Au revoir [:fantaroux:2]](./images/smilies/fantaroux.gif)
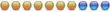
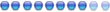
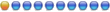
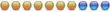
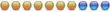
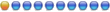
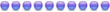
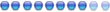

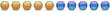
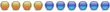
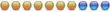
Philemon a écrit:J'ai frôlé l'attaque, j'ai cru que c'était une rencontre avec Moore !
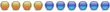

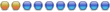
Miss Goldgruber a écrit:Philemon a écrit:J'ai frôlé l'attaque, j'ai cru que c'était une rencontre avec Moore !
oui j'ai relu plusieurs fois moi aussi
mais Claro c'est bien aussi

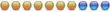
Le prétexte était tout trouvé pour rencontrer une légende de la pop culture sur laquelle courent tant de bruits (magicien, adorateur d'une déesse-serpent, consommateur invétéré de psychotropes). Alan Moore vient de sortir un roman-fleuve, à l'image de ses chefs-d'œuvre graphiques et dessinés (par d'autres), de 1 300 pages, qui a fait se pâmer toute la presse anglo-saxonne. Jérusalem sortira pour la rentrée littéraire prochaine (aux éditions Inculte), et il se murmure que Claro, le traducteur-star de Salman Rushdie, Thomas Pynchon ou William T. Vollmann, a rarement autant souffert sur un livre pour rendre l'invraisemblable prose du barde de Northampton. Loin de l'image du barbu érémitique et misanthrope, dont ses œuvres sont bien plus responsables que lui, Moore s'est donc confié longuement, généreusement. Sur Jérusalem, bien sûr, hymne mystico-élégiaque à sa ville chérie de Northampton, mais aussi sur la politique, l'éternel retour et aussi tout de même, un peu, sur la bande dessinée, qui restera son premier amour, mais qu'il va, promis, juré ( ?), quitter définitivement.
Le Point Pop : Jérusalem est une ode à votre ville natale. Pourquoi n'avez-vous jamais quitté Northampton, malgré les multiples offres qui vous sont parvenues, en particulier aux États-Unis ?
Alan Moore : Lorsque j'avais une trentaine d'années, on m'a proposé d'aller vivre à Londres. Mais je n'aime pas Londres, excepté comme sujet de fiction. Et puis des gens m'ont dit : « Pourquoi alors ne pas partir aux États-Unis » ? J'ai visité deux fois les États-Unis. La dernière en 1997. Je n'y retournerai jamais. Mais je dois admettre que, quand j'y suis allé, je n'ai vu l'Amérique qu'à travers la bulle de son industrie du divertissement. Et c'était grotesque. Vous savez, avant 1920, l'Amérique n'était pas vraiment un pays très cohérent. Il n'y avait rien qui le faisait tenir ensemble, pas plus une nationalité qu'une religion. Il y avait toutes ces communautés d'immigrants désespérés, qui n'avaient rien en commun les uns avec les autres. C'est seulement avec la culture populaire, au début du XXe siècle, que les Américains ont compris qu'ils aimaient tous les mêmes bandes dessinées, qu'ils tapaient leurs orteils sur la même chanson populaire à la radio – la radio, c'était quelque chose dans les années 20 – et alors la marge, comme on dit, est devenue le centre. L'Amérique s'est transformée en un corps gigantesque, composé d'une seule classe moyenne, mais qui n'a pour autant jamais cru dans un système de classes. Et c'est pourquoi vous pouvez vous retrouver avec un milliardaire qui a vécu sur son héritage d'être élu pour représenter la voix du peuple. Alors certes, je vois principalement l'Amérique par le filtre empoisonné de l'industrie du comics, mais je n'ai jamais senti que c'était un endroit où je souhaitais revenir, encore moins pour y habiter. On m'a aussi suggéré à un autre moment d'habiter en Irlande, parce qu'à ce moment-là, et je ne sais pas si c'est encore le cas, les écrivains ne payaient pas d'impôts. C'est un joli concept libéral comme je peux les aimer, mais le seul problème était que je ne voulais aucunement vivre en Irlande. Dans ma perception des relations entre l'argent et les individus, l'argent est la dernière chose qui doit contrôler vos choix, et la dernière raison qui doit vous faire quitter la ville que vous aimez et avec laquelle vous ne faites qu'un.
Qu'est-ce qui vous fascine tant dans votre ville de Northampton ?
En fait, j'ai déjà traité plusieurs fois de Northampton dans mes œuvres. Une série de bandes dessinées qui s'est interrompue, Big Numbers, se déroulait dans une ville nommée Hampton, qui est en fait l'un des anciens noms de Northampton. Et puis il y a eu La Voix du feu, où j'ai décidé de prendre des extraits de différents lieux de la ville, en leur associant un personnage tiré d'une période historique spécifique qui parlerait à la première personne. Et à la fin, j'avais réduit la ville à douze vies, et aussi intéressantes soient ces vies, je trouvais qu'elles ne rendaient pas compte de sa richesse et de sa complexité. Avec Jérusalem, j'ai voulu écrire sur les quartiers où j'ai grandi, qui formaient historiquement la totalité de Northampton. Et puis je me suis dit : je veux écrire sur ma famille, parce que j'avais découvert des histoires incroyables sur elle et qui méritaient d'être racontées. Et puis je me suis dit aussi : je voudrais raconter les histoires des personnes qui sont passées par ce lieu ou qui s'y sont installées. Mais je voulais le raconter avec une perspective de classe, qui est encore inhabituelle en littérature. La working class apparaît généralement sous deux formes : soit on déplore sa vulgarité, sa stupidité, sa brutalité, son alcoolisme, soit on la prend en pitié, pour les mêmes raisons. Mais malgré la dépravation de leur vie, la honte qu'ils peuvent représenter, les pauvres seront toujours avec nous, à nos côtés. Ces deux points de vue ne sont donc guère utiles, et aucun d'eux ne correspond à la façon dont les pauvres se voient. Ils sont les héros de leur propre narration, comme nous le sommes tous.
Jérusalem est un magnifique hommage à la working class anglaise. Mais cette classe existe-t-elle même seulement encore ? Certains évoquent sa disparition depuis les années Thatcher.
J'ai haï madame Thatcher, mais j'ai haï encore davantage Tony Blair, surtout parce qu'il a séparé le Parti travailliste de son engagement à respecter « la Clause IV », qui le liait au socialisme. Il a modernisé le parti, en disant : eh bien, le socialisme, tout ça, c'est un peu vieux jeu, non ? Nous devons accepter que nous travaillons dans un monde de libre échange. Et puis il y a eu ce fameux discours où il déclarait benoîtement : nous faisons tous partie de la classe moyenne à présent, n'est-ce pas ? Eh bien, non, Tony, ce n'est pas le cas. Peut-être est-ce comme ça autour de toi, ou à Islington (quartier chic londonien, NDLR), mais si tu vas plus au Nord… Si nous devions effectivement quitter l'Europe, la seule consolation, de mon point de vue, serait que cela rendrait Tony Blair furieux. Je me souviens de mon père, un ouvrier qui travaillait dans une brasserie, et qui me disait, d'une façon un peu naïve, comment le futur serait merveilleux pour les personnes de sa condition. Des machines les remplaceraient, elles pourraient bénéficier de loisirs… Il était loin d'imaginer qu'il n'y aurait plus du tout de travail pour des gens comme lui, qu'il n'y aurait plus de raisons qu'on leur donne de l'argent, et qu'il faudrait vivre sur les allocations, du moins tant qu'il y aura des allocations. Je pense à un passage d'un livre de Slavoj Zizek…
Il y a d'ailleurs un petit air de ressemblance entre vous…
Oui, mais s'il est meilleur philosophe que moi, je le bats pour ce qui est de la barbe ! Donc dans son livre, Trouble in Paradise, Zizek raconte comment Mikhaïl Gorbatchev avait voulu rendre une visite-surprise à Willy Brandt, l'ancien chancelier allemand. Brandt avait refusé de le recevoir et avait justifié plus tard ce refus en expliquant qu'avec la fin du communisme, ce serait aussi la fin de l'État providence dans les pays occidentaux. Car ce type de protection trouvait sa justification dans la nécessité de détourner les classes laborieuses du communisme. Une fois cette alternative disparue, pourquoi s'embarrasser de l'éducation pour tous, de la sécurité sociale, des retraites.
Si les gens dans ce pays étaient mieux éduqués, mieux formés, mieux protégés, auraient-ils voté pour le Brexit ? L'éducation des classes populaires, du point de vue des classes dominantes, semble une très mauvaise idée. Parce que, si vous les éduquez, leurs attentes grandiront, de même que leur colère, et ils essaieront aussi de s'organiser. Alors, il faut leur donner un système éducatif d'un standard moindre et qui favorise les classes moyennes et supérieures, ainsi que des médias qui visent systématiquement au dénominateur commun le plus bas. Le raisonnement de George Orwell était que, si les gens ne possèdent pas de langage, eh bien, ils ne disposent pas non plus des concepts. Je crois que le lecteur moyen du Sun ne doit avoir besoin que de 10 000 mots. Mais si vous étendez le langage des individus, vous provoquez également l'expansion de leur conscience. C'est ce que j'essaie de faire avec mes livres et, dans le cas de Jérusalem, ma plus grande victoire a été que mon frère, qui n'est pas un grand lecteur – je ne crois pas qu'il n'ait jamais lu un classique en littérature de sa vie –, l'ait lu entièrement et l'ait aimé. Si j'avais écrit un livre destiné seulement à plaire aux critiques littéraires, cela aurait été pour moi un monstrueux échec étant donné ce qu'est Jérusalem, ainsi que son sujet. Cela signifierait qu'il est hors d'atteinte des gens pour qui je l'ai écrit, et dont le roman parle.
Cela doit donc vous faire plaisir quand les Anonymous, ce mouvement d'hacktivistes libertaires et contestataires, se revendiquent de votre héros anarchiste V en reprenant son masque.
Je souhaite bon vent aux mouvements protestataires, mais lorsque j'ai des personnes qui me demandent : « Alors, vous êtes en contact avec les Anonymous ? », je réponds : « Bien sûr que non. » Parce que je ne suis pas moi-même anonyme. Ce n'est pas un masque que je porte. Je suis heureux que quelque chose soit sorti de ce livre et qu'il ait trouvé sa place dans un mouvement protestataire global. Mais comme je me suis détaché des livres dont je ne possède plus les droits, ce qui inclut V pour Vendetta, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je voulais même qu'ils retirent mon nom des couvertures des albums, car je pensais qu'ils auraient pu vendre le livre avec le seul nom de David Lloyd (le dessinateur de V pour Vendetta) dessus. Mais il faut croire qu'ils pensent autrement, car ils gardent mon nom, et l'argent qui va avec ! À l'heure actuelle, je ne touche plus rien sur 60 % de ce que j'ai produit, peut-être plus, ce qui représente une énorme somme d'argent. Lorsque vous êtes privé de ce que vous avez inventé et aimé, la douleur émotionnelle – je crois que le mot n'est pas trop fort – est réelle, comme celle d'un enfant qui dirait : « Je ne verrai plus jamais ce livre que j'adore ni n'en entendrai parler de ma vie. » Mais, heureusement, j'ai conservé les droits sur bien d'autres œuvres, souvent moins connues, et dont je suis très fier. En revanche, d'autres choses m'intéressent dans le fait que le masque des Anonymous, tout comme le smiley des Watchmen, devenu un symbole pour le mouvement de l'Acid House, se soient diffusés dans le monde. Cela me confirme l'extrême porosité entre la réalité et la fiction. Tout ce qui nous entoure, le langage que nous utilisons, les vêtements que nous portons, tout a commencé par la pure imagination.
Mais vous ne pouvez nier qu'il existe une portée politique dans vos œuvres ! Vous vous définissez vous-même comme un anarchiste.
L'anarchisme est la façon la plus naturelle de faire fonctionner les choses. La plupart des familles, par exemple, ne fonctionnent-elles pas de cette façon ? Avec des négociations entre parents et enfants, maris et femmes. Ce n'est pas c'est moi le patron, et voilà comment va fonctionner cette famille. Par leur nature propre, les hommes sont anarchistes. Je lisais une citation, il n'y a pas longtemps, de David Lloyd où il disait qu'il aurait vraiment aimé que je ne fasse pas de V un anarchiste, parce que, je le cite, « mais quand cela a-t-il jamais fonctionné ? » Eh bien, cela a fonctionné parfois, avec la Commune de Paris ou la communauté huguenote à Londres. Et il y a plus longtemps encore, il y a quelques centaines de milliers d'années, quand nous étions des chasseurs et que le plus grand tabou, ce n'était pas le meurtre ou l'inceste, c'était le statut. Si vous vouliez dépasser votre statut et avoir une plus grosse part du gâteau que les autres, c'était le plus grand crime. D'abord, vous étiez probablement ridiculisé devant le groupe, et si cela ne suffisait pas, on vous ostracisait. Ce qui, après tout, devait signifier la mort.
En même temps, la dimension politique de Jérusalem doit être envisagée aussi avec des éléments « fantastiques » qui prennent tellement de place dans notre vie. Notre histoire véritable et personnelle ne peut pas se limiter à l'histoire de nos circonstances matérielles. C'est aussi l'histoire de ce que nous avons imaginé, comment nous avons perçu ces circonstances, nos aspirations, nos idées religieuses. J'ai reçu une lettre d'un lecteur de Jérusalem, une lettre extraordinaire, qui me disait qu'un événement de son enfance revenait sans cesse. Il était assis sur son canapé, il mâchait un chewing-gum, et il comprit brutalement qu'un jour il mourrait. Il en avait été terrifié, et cela avait ouvert une sorte de brèche en lui. Il a vu de très bons thérapeutes et analystes, mais jusqu'à la lecture de mon roman, il m'a dit que rien n'avait exprimé aussi clairement de son point de vue ce problème central.
Dans vos œuvres, la religion occupe une place souvent essentielle (on pense notamment au syncrétisme à l'œuvre dans From Hell). Est-elle justement une solution à la peur de la mort ?
Ma grand-mère maternelle était une chrétienne très dévote comme beaucoup de pauvres l'étaient, en particulier parce qu'au royaume des cieux « les derniers seraient les premiers » et qu'« il était plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche… », etc. Le ciel permet aux pauvres d'avoir leur revanche. Bon, il n'y a pas de ciel. Je ne crois pas, du moins, qu'il faille compter dessus. Moi, j'ai besoin de quelque chose qui mette l'accent non sur une vie après la mort, mais sur un « ici et maintenant ». C'est là que nous sommes encore en vie, là où nous prenons des décisions. Je pense que Nietzsche pensait à peu près cela, mais qu'il avait tort sur un point : lorsqu'il dit que l'univers est infini et que, s'il est infini, alors cette planète reviendra à sa forme initiale un nombre infini de fois. Mais ce n'est pas vrai. L'univers est très grand, mais il n'est pas infini. En revanche, se poser la question de savoir, avec Nietzsche, la conséquence de vos actions, une fois que vous envisagez que ce que vous faites, vous risquez de le refaire infiniment, et donc de vous dire : « C'est donc ça ce que je veux faire potentiellement un nombre infini de fois ? », ça, c'est véritablement un moyen d'agir sur le monde. En tout cas, davantage qu'en portant un masque de Guy Fawkes à mon sens.
Après Jérusalem, que toute la presse anglo-saxonne salue comme un chef-d'œuvre en évoquant Thomas Pynchon, ou David Foster Wallace, vous imaginez-vous revenir à la bande dessinée ?
La bande dessinée s'est embourgeoisée. Maintenant, on parle de roman graphique – une invention d'un département de marketing quelconque. La raison pour laquelle j'aimais les bandes dessinées est qu'elles parlaient à tout le monde, par-delà les classes sociales. Elles ne remplissent plus cette fonction désormais. Lorsque j'étais enfant, je pouvais descendre et acheter au magasin du coin 24 pages d'une nouvelle œuvre de génies comme Jack Kirby ou Steve Ditko, et cela pour 9, 10 pence. De nos jours, il n'y a plus que des romans graphiques, des livres pour table à café. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me retire de la bande dessinée. Kevin et moi, nous allons faire un volume supplémentaire de La Ligue des gentlemen extraordinaires, nous en discutons en ce moment même. Et après cela, j'en aurai fini avec la bande dessinée
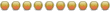
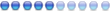
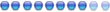
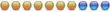
Retourner vers Bande Dessinée étrangère
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités