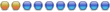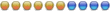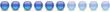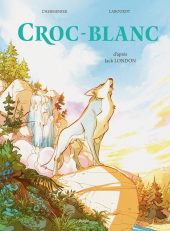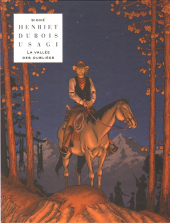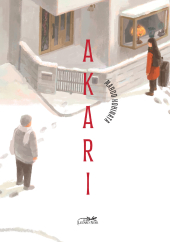Beware of the SPOILER!
Je viens partager mes impressions sur Black Science à l’aune de la fin de la série parue la semaine dernière chez nous. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle éclaire autant qu’elle est informée par tout ce qui l’a précédé. En prouvant définitivement avec ce finale en apothéose une mainmise totale sur son récit, Remender se positionne indubitablement comme un poids lourd de la SF contemporaine, et sa saga interdimensionnelle avec lui.
Pourtant, après un pénultième opus assez faible, la confiance est au plus bas avant d’entamer ce neuvième et dernier volume. En effet, le tome 8 se détachait de l’horizontalité scénaristique et narrative qui avait jusque-là prévalue et apporté sa singularité à la série. En abandonnant sa trame faite de redondance de situations et de permanence de conflits philosophiques constamment réactualisés sans jamais être tranchés pour creuser une mythologie de l’infiniverse à peine ébauchée, et même largement ignorée durant la majorité du run, l’intrigue s’égarait dans une impasse méta complétement déplacée au regard des intentions affichées depuis ses débuts par un scénario dont les enjeux ont toujours reposés sur les épaules de ses personnages, et surtout sur celles de son protagoniste, Grant McKay, dont le moindre choix aura été questionné et remis en perspective par les événements.
Cette décision ne pouvait déboucher que sur des considérations superficielles par trop éloignées du cœur battant de la série. Difficile de revenir de cette impasse sans y laisser des plumes. Encore plus de récupérer le fil de l’histoire, comme le suggérait des retrouvailles malvenues en guise de cliffhanger, qui ne concluaient pas l’arc narratif de manière satisfaisante et n’ouvrait en apparence que sur un long happy end faisandé. Sauf que.
Sauf que cet arc n’est en rien une conclusion avortée, mais plutôt une manière de refermer les portes sur des pans entiers de l’univers sans apporter de solutions aux personnages, de leur dénier toute échappatoire avant de les confronter une dernière fois au thème principal de la série, le choix et le libre-arbitre. Le tome 9 reprend cette entreprise de démolition sans plus en cacher les enjeux réels et pousse la logique à son paroxysme avec
la mort qui balaie les personnages, d’un revers de main d’une cruelle désinvolture, laissant un Grant exsangue. Un grand bravo à Scalera au passage, qui en une poignée de cases, et notamment une mémorable sur le visage de son anti-héros, parvient à faire passer toute la folie de cet instant diabolique. L’économie de sa narration n’a d’égal que le désespoir qu’elle dépeint.
Avec ce rebondissement définitif, Remender acte le fait que ni la pensée magique, ni le technobabble, ni les lieux communs et techniques scénaristiques du pulp qu’il affectionne tant ne pourront plus dénouer son intrigue. Il se coupe de toutes ses alternatives pour ne plus se laisser qu’une seule option satisfaisante, la plus ambitieuse et casse gueule à la fois, celle d’adresser les thèmes de la série pour les unifier en une fin cohérente. Entre alors en scène Kadir.
La dynamique principale qui fonde l’intérêt de la série oppose l’idéalisme libertaire aux tendances anarchistes de Grant au pragmatisme et au relativisme moral de Kadir, sa némésis de toujours. Le personnage n’apparait au départ que comme le méchant de service, aux motivations au mieux ambigües auxquelles il est impossible d’adhérer. L’auteur crée un jeu de miroir provoquant l’empathie pour son protagoniste sans avoir à transiger sur sa personnalité complexe et les nombreuses failles qui la compose. Le lecteur devine facilement que Grant McKay est un sale con égoïste, mais mis en présence de Kadir, c’est surtout un type bien intentionné qui essaye de faire au mieux.
Kadir n’aurait été que cela, il aurait eu toute sa place dans cette histoire. Mais voilà, Remender va s’extraire de ses habitudes tirées du pulp en doublant sa mécanique narrative d’enjeux thématiques et de mécanismes psychologiques tellement intriqués qu’ils vont s’enrichir mutuellement et lester des péripéties en d’autres circonstances inconséquentes du poids certain de la réalité. On peut s’extasier sur les progrès de l’auteur depuis Fear Agent il y a une décennie. Alors qu’il applique la loi de Murphy aux mésaventures de Heath Houston comme aux tribulations de Grant McKay, ce n’est dans le cas du premier que pour le pur plaisir du rebondissement inattendu et de l’emballement de l’intrigue au service d’un hommage aux histoires qui l’ont inspiré. Black Science, quant à elle, met son développement narratif au service d’un propos abouti et ambitieux, en parfaite adéquation avec les enjeux de son univers de SF, malgré la proéminence de quelques tics d’écriture risquant parfois de verser dans la pompe - ahh… toutes ces voix off qui se mélangent au point d’avoir besoin d’un code couleur pour les différencier – ou une tendance à se disperser - ahh… cette ligue de super héros alternative, hommage superflu à un genre qui n’en a pas besoin. Des défauts bien insignifiants en comparaison de ses accomplissements par ailleurs.
Non des moindres est donc le personnage de Kadir. Le mérite de Remender, et probablement une des plus grandes réussites de sa carrière, aura été de sculpter inlassablement ce cliché unidimensionnel pour en faire "un vrai petit garçon". La structure de l’intrigue, construite délibérément en une répétition des enjeux d’arc en arc, de monde en monde, permet de révéler les personnages. En les confrontant encore et encore aux mêmes choix, la multitude que chacun abrite se dévoile selon qu’ils prennent ou non les mêmes décisions. Si Grant est particulièrement soigné par ce dispositif narratif, c’est bien Kadir qui en profite le plus. Au fur et à mesure de l’intrigue, son discours, qui ne sonnait au début que comme l’autojustification de ses exactions, s’élabore et se mue en une véritable contreproposition philosophique à celle de son antagoniste, toute aussi radicale et intelligible. D’un côté un éternel insatisfait qui cherche à créer un monde meilleur en imposant à tout et tous ses propres règles et dont l’intellect supérieur lui offre les moyens de ses prétentions, de l’autre un monstre d’ambition qui s’est résigné depuis longtemps à accepter l’idée qu’on ne peut ignorer ni les règles qui régissent le monde ni les volontés d’autrui, et qu’il est nécessaire de s’y plier pour atteindre ses objectifs, trouver sa place et peut-être un peu de compassion et de compréhension auprès des autres, quitte à accepter les compromis les plus douteux. Cette opposition met en tension tout le récit, lui apportant sa richesse et sa complexité, et Remender l’a bien compris. C’est pourquoi il ne se trompe pas en recentrant la conclusion de son intrigue sur cette dualité.
Si l’on n’en comprend pas les intentions, les trois derniers numéros de la série peuvent donner l’impression d’être catastrophiques. Le principe est le même que la fin d’Evangelion. Le scénario débranche brutalement l’action pour suivre le cheminement psychologique de son protagoniste vers le choix le plus important de sa vie. Là où l’élève dépasse le maître, c’est dans la forme que prend cet ultime choix, qui résonne avec des éléments fondamentaux de la série pour révéler une vérité fort bien cachée sur la nature humaine.
Kadir, la compromission incarnée, a donc vaincu la toute puissante sorcière dimensionnelle Doxta de la seule façon qu’il était possible de le faire, en lui proposant un marché qu’elle ne pouvait pas refuser. Le fait qu’on ne découvre jamais la teneur du pacte scellé est savoureux car la méthode suffit à identifier exactement le parcours du personnage et ce qu’on a appris à attendre de lui. Cela compte au final moins que de valider sa vision du monde.
Plus que le pouvoir, Kadir obtient la permission de refonder l’infinivers à son image, la différence tenant à ce que le scénario ne tranche pas définitivement l’antagonisme primordial sur lequel il repose, ni ne le fera jamais. Et le multivers qu’il édifie n’est pas aussi terrible que le laissait supposer la vindicte qu’il a subi une grande partie de l’histoire. Il s'appuie même sur un système ressemblant étrangement au crédit social chinois, un bien petit prix à payer pour rester équilibré et en bonne santé, presque sécurisant. Sauf évidemment pour Grant McKay, qui préfère être libre qu’heureux.
Le choix est simple, continuer à se battre pour son idéal ou enfin accepter son sort.
Remender utilise brillamment le principe d’univers quantique à la base de tout son scénario pour établir un dispositif qui lui permet de suivre les conséquences du choix de son personnage principal dans les deux mondes qu'il a créé. Ce qui signifie implicitement qu’il portait en lui ces deux choix diamétralement opposés aux répercussions dramatiquement symétriques. Ces Grant que les agissements éloignent l’un de l’autre à mesure que les événements divergent sont malgré tout parfaitement reconnaissables. Aussi contradictoires que soient désormais leurs comportements, ils ont toujours été capables des deux, parfois dans un même élan. Ce que raconte cette narration schizophrénique, c’est l’intériorité des individus, aussi vaste que paradoxale. Tellement qu’elle ne peut être traduite toute entière par leurs actes. Les décisions que l’on prend ne peuvent en aucun cas suffire à définir tout un chacun. Bien souvent, les choix que l’on fait relèvent de l’arbitraire plus que du libre arbitre. Tiraillés par ses contradictions, c’est dans la confusion et presque par défaut que l’on agit, une fois confronté au mur du réel.
Dans un élégant mouvement de boucle scénaristique, cette émouvante réflexion en forme de point final des aventures de la famille McKay renvoie immanquablement au funeste augure qu’avait prophétisé il y a longtemps un Grant alternatif au héros malheureux de cette histoire, laissant deviner le caractère le plus tragique cette prédiction: il n'aurait tenu qu’à lui de la défaire.
En mijotant cette fin grandiose à une série qui jusqu’alors était de très haute tenue, Remender l’élève ostensiblement au-dessus de sa condition supposée de divertissement pour en faire un monument de SF moderne et innovante, dont le seul tort est d’être un comic un peu trop mainstream au dessin un trop pop produit par une industrie un peu trop standardisée pour être pris au sérieux. Mais surtout, elle aura à mon avis souffert du manque d’exigence d’une presse culturelle dont la qualité de l’appareil critique est pour le moins fluctuante et qui de toute façon réserve le plus souvent les quelques signes qu’elle alloue à la BD au sacrosaint roman graphique, quand on la trouve à foison pour le cinéma, la musique ou même maintenant les séries TV. Cette BD peut trop facilement être ignoré pour ce qu’elle représente alors qu’elle mériterait d’être reconnue pour ce qu’elle raconte. Il ne sera heureusement jamais trop tard pour la redécouvrir.
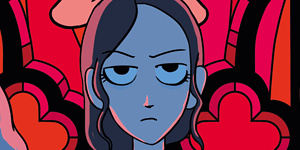
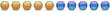
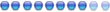
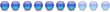


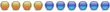
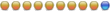
![Au revoir [:fantaroux:2]](./images/smilies/fantaroux.gif)