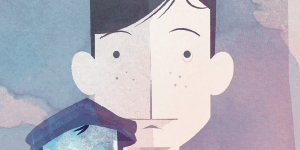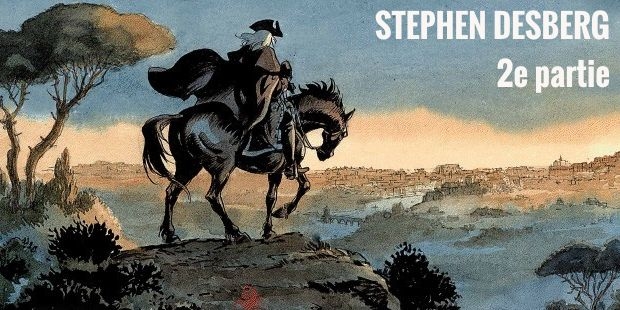
De l'expérience, Stephen Desberg en a à revendre. De ses premiers pas chez Dupuis à ses dernières productions au Lombard ou chez Dargaud, il a multiplié les collaborations en essayant, à chaque fois, d'en extraire ce qu'il y a de meilleur. Quel est aujourd'hui son regard sur le monde éditorial ? Comment travaille-t-il avec ses dessinateurs ? Quels sont ses projets à venir ? Voici quelques éléments de réponse dans cette seconde partie d'interview.
Pour quelles raisons vous êtes-vous éloigné des one shots ?
J’aime bien construire. Je discutais encore récemment de ça avec un dessinateur avec qui j’ai envie de travailler mais qui est aujourd’hui occupé par une autre série. Il me disait : « Faisons un one shot ! ». Mais les personnages qu’on avait en tête, j’ai envie de les développer, peut-être pas dans une série de vingt albums, mais dans des cycles. Pour ça, le one shot me frustre un peu.  Même s’il n’est pas rare de rencontrer aujourd’hui de gros one shot de plus de cent pages ?
Même s’il n’est pas rare de rencontrer aujourd’hui de gros one shot de plus de cent pages ?
On est actuellement sur un diptyque de Black Op qui fait suite aux six albums du premier cycle. C’est en quelque sorte un one shot puisque les personnages sont différents, et il n’y aura pas de suite. Je trouve aussi que les gros volumes posent des problèmes économiques. On ne défend pas auprès de l’éditeur de la même façon un album de cent-vingt pages qui va coûter une vingtaine d’euros comme on défendrait un simple one shot. Je ne dis pas que je n’en ferai pas, mais, naturellement, mon désir de construction de personnages m’en empêche. Je suis fasciné par la série télé Game of Thrones. J’ai lu aussi tous les romans. Ce qui m’impressionne, c’est cette façon de retourner les personnages : ceux qu’on aime et qui se révèlent très décevants, ceux qu’on déteste et qu’on finit par aimer… On finit par être sur ses gardes. Et ça, ça ne peut se faire que sur la durée. En bande dessinée, la tradition de créer un héros et un méchant récurrent pour partir sur une série de vingt ou trente albums, c’est quelque chose qui est en train de mourir. Il y a néanmoins des limites à ne pas franchir. Le lecteur peut finir par être déconnecté du héros car il fait des choses inacceptables… Je trouve que les américains, dans les feuilletons, sont toujours à la recherche de cette limite. J’aime aussi beaucoup la série Mad Men. Il y a des moments où le héros fait certaines choses que je suis certain qu’il va regretter. Malgré cela, on garde toujours le contact avec le personnage. Il ne franchit jamais la limite qui me ferait dire : « Là, je ne suis pas d’accord, je ne te suis plus. » Et ça, c’est très fort. Je suis un peu dans cette recherche-là : essayer de voir jusqu’où on peut aller sans perdre son lecteur.
Est-ce vous qui recrutez les dessinateurs pour les séries d'albums à sortie rapprochée ? Ou est-ce que vous laissez ce soin à vos éditeurs ?
J’ai vécu beaucoup de relations scénariste-dessinateur qui n’ont pas marché. Souvent, c’est parce qu’on ne veut pas raconter la même chose. Je pense qu’il faut être sincère dans les intentions. Mon rôle est de vraiment bien expliquer au dessinateur ce que je veux raconter, puis ensuite qu’on travaille ensemble. Le principe où le scénariste fait ce qu’il veut, puis cherche ensuite un dessinateur, ça marche parfois ; avec le dessinateur américain dont je vous ai parlé par exemple. Je trouve que souvent, après un certain temps, ça foire. On a envie de prendre des directions différentes. Un projet comme Empire USA, j’y croyais beaucoup au moment où je l’ai fait, pour des raisons scénaristiques. Je pense que pour des questions d’implication des dessinateurs, mais aussi de suivi du public, ce n’est pas dans les mœurs franco-belges. Tout le monde était très excité au début. La première saison a d’ailleurs été un vrai succès. Sur la deuxième saison, je me suis rendu compte qu’il y avait encore une bonne partie du public qui nous suivait, mais une autre ne souhaitait pas voir des personnages interprétés par des dessinateurs différents. Ces lecteurs-là pensent que comme le travail est plus vite fait, il y a moins d’âme car les dessinateurs sont interchangeables. Ce qui n’est pas le cas. Ils se sont beaucoup investis dans ce qu’ils ont fait, mais d’une autre manière. Je le sentais dans tout ce qui était rapport avec l’éditeur ou la promotion. C’était uniquement moi qui m’en occupais. Les dessinateurs me disaient que c’était mon projet et que c’était donc à moi de le faire. En même temps, il n’y a pas la rencontre dessinateur-scénariste, l’envie de développer quelque chose ensemble. Cela fait des années que je travaille avec Marini (L’Étoile du Désert, Le Scorpion). J’ai avec lui une relation vraiment privilégiée. Ce sont nos personnages… Quand je vais le voir en Suisse ou que lui vient à Bruxelles, tout en se baladant on discute de l’évolution des personnages… On a créé ensemble un espace de liberté et de création qui donne, à mon avis, la couleur de ce qu’on fait. Je n’ai pas cette relation-là avec tous les dessinateurs, simplement parce que les personnalités sont différentes. Marini a le besoin d’être impliqué dans ce qu’il dessine, d’ailleurs il écrit lui-même des scénarios. Avec Labiano, par exemple, j’ai un autre type d’équilibre dans nos rapports. Avant de lui confier un scénario, on se voit avant, on en discute, on parle de ses envies, de politique…
Labiano nous a justement confié qu’il a désormais tendance à s’impliquer davantage dans l’écriture depuis qu’il a écrit son propre scénario…
Oui, tout à fait. Marini m’avait dit quelque chose qui m’a fait énormément plaisir quand il a sorti Les Aigles de Rome : « Je me suis rendu compte que j’aurai toujours des critiques à faire à mon scénariste même s’il s’appelle Marini ». (sourire) Je trouve ça intéressant. Effectivement, un dessinateur et un scénariste n’ont pas le même cahier des charges. Le dessinateur a souvent envie de se faire plaisir, de dessiner des choses qui sont toujours excitantes. Alors que dans un scénario, il y a fatalement un moment où ce sera beaucoup moins excitant à dessiner, tout simplement parce que c’est nécessaire à l’histoire. Souvent avec Enrico Marini, dans Le Scorpion, il me demandait pourquoi je ne m’attardais pas plus sur l’un ou l’autre des personnages. Je lui expliquais que je ne voulais pas faire trente albums de cette série et qu’il fallait que j’avance dans l’intrigue. Le scénariste a la responsabilité de la narration. On n’a pas toujours les mêmes priorités et c’est très chouette quand on arrive à se compléter.

Le fait d’avoir du succès à un moment de sa carrière permet d’avoir beaucoup plus de liberté. Mais ce n’est pas quelque chose dont il faut abuser. J’ai eu des collaborations avec des dessinateurs qui sont beaucoup plus jeunes et ce n’est pas pour cela que je leur ai imposé trop de choses en raison de mon expérience. Il y a des richesses dans les univers de chacun. Par exemple, malgré ma différence d’âge avec Marini, il m’a fait découvrir plein de choses, notamment en matière de cinéma. Cela m’a fait beaucoup évoluer. Ce serait ridicule de me dire que je n’ai rien à apprendre de gars qui ont trente ans. Au contraire. Il y a donc une certaine liberté, c’est vrai, mais elle doit être utilisée d’une manière intelligente et ouverte, de façon à laisser de la place à l’autre.
Il existe souvent une contradiction chez les lecteurs : celle de vouloir absolument un travail soigné tout en ayant des sorties rapprochées entre les différents tomes d’une série…
Il y a beaucoup de contradictions chez les lecteurs. Ils se plaignent quand les histoires sont trop longues et d’un autre côté ils sont très pressés, veulent avoir les enjeux tout de suite tout en souhaitant beaucoup d’originalité. Or, avec tout ce qui sort et tout ce qui est déjà sorti, que ce soit en bande dessinée mais aussi en romans ou en jeux vidéo, on a besoin de temps si on veut faire quelque chose d’un tant soit peu original. Je vois parfois sur internet ce genre de réactions. Sur ce medium, j’ai l’impression que les gens sont encore plus pressés qu’ailleurs. Dès qu’ils lisent une BD, ils doivent donner leur avis tout de suite. Et cet avis est souvent catégorique, même s’ils n’ont lu que dix pages. C’est contradictoire… Il y a le plaisir d’aller acheter quelque chose et le plaisir de le démolir immédiatement. On en vient à se demander pourquoi les gens dépensent de l’argent. C’est quelque part la quadrature du cercle. Sur Le Scorpion, la majorité des lecteurs nous demandent de ne pas nous arrêter, tandis que d’autres nous disent que cette série devrait être terminée depuis longtemps. On est convaincus depuis le début que l’intrigue principale n’est pas l’unique raison d’être de la série, il y a d’autres choses que j’ai toujours voulu développer. Ce n’est pas le succès qui m’a fait rajouter d’autres albums.
Vous êtes un pilier du Lombard : ressentez-vous comme nous que la vénérable maison prend une orientation un peu différente ?
Il y a eu des changements de directeurs éditoriaux. Fatalement, la sensibilité de chacun influe sur le catalogue. J’ai la chance que tout le monde au Lombard est très sympa avec moi. Que ce soit chez eux ou chez Dargaud, ils sont toujours intéressés par mes projets. Je crois qu’on se rencontre car ce que j’ai envie de faire rentre assez facilement dans leur politique éditoriale et vice-versa. Beaucoup de personnes ont cru qu’Empire USA était une commande de Dargaud. Je ne réponds jamais à des commandes. Il se fait que souvent, on est sur la même longueur d’ondes. Le Lombard sort de moins en moins de nouveautés et ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes auteurs. C’est la beauté et le problème de la bande dessinée. Proportionnellement, éditer une bande dessinée ne coûte pas très cher. La politique est la suivante : on sort un paquet de trucs et on voit dans le tas ce qui va marcher. Le problème inhérent est la surproduction. Les lecteurs sont alors noyés et ne savent plus comment suivre. Les éditeurs devraient faire plus de choix et s’investir plus. Maintenant, je sais que c’est très facile pour moi de dire ça, sachant qu’ils seront ouverts à mes projets.
Vous êtes le « survivant » de la collection Troisième Vague. On ne vous a pas proposé un poste de directeur de collection ?
(rires) Non. C’est un métier difficile. Quand je vais voir un film et qu’il me plait, je le regarde comme un spectateur lambda. Dès que quelque chose me chagrine, je sors de l’histoire et je commence à analyser : « Si on m’a mis cet élément-là, c’est qu’il va se passer ça… » Si je deviens directeur de collection et que je commence à intervenir dans le travail d’autres scénaristes… J’ai eu chez Dupuis des directeurs éditoriaux qui intervenaient et qui avaient des idées très précises sur ce qu’ils souhaitaient. Ça ne marche pas comme ça. Il faut choisir des auteurs mais aussi leur laisser du temps de se développer, d’apprendre… Aujourd’hui, cette phase d’apprentissage n’existe pratiquement plus. On sort un bouquin qui ne marche pas et on est très vite catalogué.
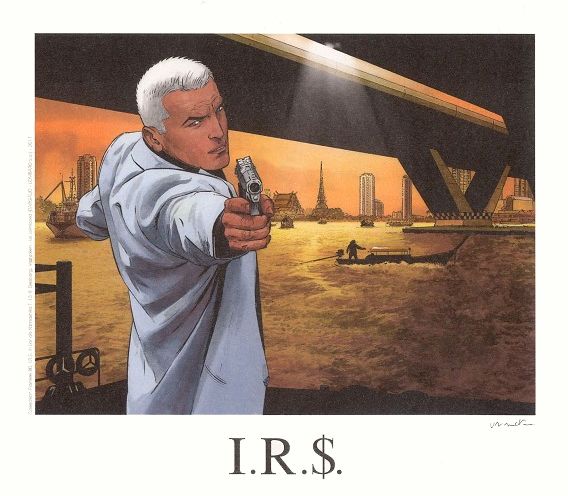
J’en ai parlé : un projet avec un dessinateur américain qui vit à Los Angeles. C’est un vrai thriller réaliste où il y a beaucoup d’humour, un humour de dialogues un peu comme Tarentino peut le faire. On fait très peu ce genre de choses en bande dessinée. Quand on est dans une histoire sérieuse, en principe, on le reste. IR$ est un bon exemple pour ça. J’ai vraiment voulu développer dans cette nouvelle histoire des contradictions dans les personnages. C’est un chasseur de primes qui attrape des terroristes, des trafiquants de drogue. Il a une organisation de deux - trois personnes qui travaillent pour lui. Il se fait énormément d’argent mais sa vie privée est une catastrophe. Ce sont ces contrastes-là qui m’ont intéressé. Le dessinateur est un américain mais il connaît aussi très bien la bande dessinée franco-belge. Il a fait une synthèse de ces deux univers et comprends magnifiquement bien les personnages. C’est un super gars qui viendra en Belgique pour la sortie du premier tome. Je ne veux pas le comparer à Marini mais c’est quelqu’un d’intelligent qui a une expérience de vie, et les discussions que j’ai avec lui sont très riches et il comprend chaque fois très bien là où je veux en venir. C’est grâce au Lombard que je l’ai rencontré, par l’intermédiaire d’Antoine Maurel, l’assistant de Gauthier Van Meerbeeck. Il se rend souvent aux Etats-Unis et l’a rencontré à l’occasion d’une convention. Il lui a proposé un de mes scénarios. Il me connaissait au travers de Scorpion, ce qui est plutôt étonnant pour un américain, et a accepté. Souvent pourtant, ce genre de contact ne donne rien. Et là, ça a marché. (sourire)
J’ai un autre projet en quatre tomes avec Griffo. Cela se passe au 19e siècle en Angleterre. C’est un peu étonnant, mais l’histoire est inspirée de celle de Led Zeppelin. Ce sont quatre gangsters qui forment un groupe, des voleurs de haut vol. Les relations qui existent entre eux sont vraiment basées sur l’histoire de Led Zeppelin. Je suis moi-même musicien et j’adore ce groupe depuis toujours. C’est dans un style beaucoup plus enlevé que Sherman. Ça se rapproche plus de ce qu’il a pu faire dans Monsieur Noir.
Je prépare également une nouvelle série avec Bernard Vrancken qui n’a rien à voir avec IR$. Ça se rapproche beaucoup plus de Game Of Thrones, un moyen-âge avec un tout petit peu de fantastique. C’est un polar dans ce contexte-là. Le premier tome devrait sortir courant septembre 2013.
J’ai également un projet d’IR$ dans le monde du foot qui va d’appeler IR$ Team. Je suis passionné de foot et y joue toujours. Ce n’est donc pas quelque chose d’opportuniste. C’est un sport que j’adore mais dans lequel il y a des dérives épouvantables. Je suis supporter d’Anderlecht qui est mon équipe à Bruxelles. Je suis désespéré par l’argent qu’il y a en jeu et tous ces joueurs qui partent en Angleterre. En Belgique, aucun contrat professionnel ne peut être signé avant l’âge de seize ans. Ce sont donc des très jeunes qui partent à l’étranger pour pratiquement rien. Il suffit qu’un réussisse, les autres, on les jettera à la poubelle. Je parle dans cette nouvelle série de l’attribution de la Coupe du Monde et des tricheries qu’il y a autour de ça. On est chaque fois rattrapé par l’actualité. On risque d’avoir des partenariats intéressants avec l’Équipe, RMC…
Qu’en est-il du projet de télévision d’IR$ ?
On a vendu deux fois IR$ aux Etats-Unis par l’intermédiaire de Lionsgate, la deuxième fois ayant été la plus sérieuse. J’ai été invité sur place pour travailler avec un scénariste. Mais ça s’est passé juste pendant la crise des subprimes. Les chaînes de télé ont toutes dit : « C’est un chouette projet, mais ce n’est pas le moment de parler d’impôts et de finances aux Etats-Unis. » L’option est tombée mais je suis toujours en contact avec Lionsgate. Les options, on en vend tout le temps. Récemment, la boîte de Luc Besson a acheté une option pour Black Op. J’en avais aussi vendu une pour Tosca au Canada. C’était toujours plus chouette qu’il se passe quelque chose plutôt que rien du tout mais on ne va pas sortir le champagne chaque fois qu’une option est vendue. Je pense que Le Scorpion se prêterait facilement à ce genre de projets. Je ne suis pas en train de courir après ça. Je sais très bien qu’à partir du moment où on vend une série, elle nous échappe. Ce serait très difficile pour Enrico et moi de voir Le Scorpion transformé. On a vécu ça sur Billy The Cat. Quand l’adaptation a été faite en dessin animé, ils ont changé plein de trucs. Dans la bande dessinée, Billy a un accident de voiture, monte au ciel, et se réincarne dans la peau d’un chat. On nous a dit que ce genre de choses ne passait pas du tout à la télé, que ça touche des convictions religieuses. Dans le dessin animé, c’est un magicien qui punit le petit garçon car il n’a pas été gentil avec les chats. L’idéal, comme pour Game Of Thrones, est de tomber sur des gens qui adorent l’œuvre originale et qui veulent la changer le moins possible. Mais ça arrive rarement… (sourire)
- Lire la première partie de l'interview
Propos recueillis pas Laurent Gianati et Laurent Cirade