
Dans Toutes les princesses meurent après minuit - TLP pour les intimes - la symbolique a une importance majeure. De la journée qui s'égrène du matin au soir, de la mort d'une princesse qui en réveille une autre, des amours naissants et d'autres qui s'éteignent, Quentin Zuttion en fait un récit emplein d'une douce mélancolie à la fois juste dans son ton et extrêmement sensible.
Avec Toutes les princesses meurent après minuit, on tient sans doute là l'un des titres les plus longs de l'année !
Quentin Zuitton : C’est vrai qu’il est très long et c’est un enfer pour tout le monde quand il s'agit de le mentionner dans un mail ou dans un message (rires). Alors on a choisi des acronymes : c’est TLP, Toutes Les Princesses ! J’avais en tête ce titre depuis très longtemps parce que je pensais à cette histoire dans un coin de ma tête. Je voyais déjà cette introduction avec Lady Di et je voulais que le récit parle de féminité avec trois rapports au féminin différents : la maman, l’ado, et le petit enfant qui accède à sa part de féminité. Je jouais beaucoup aux poupées, j’adorais les princesses quand j'étais petit et je me suis dit que Toutes les princesses meurent après minuit ferait un joli titre poétique…
Vous dites que c'est l’album le plus personnel que vous ayez fait. Était-il important de travailler sur d'autres ouvrages avant de vous attaquer à celui-ci ?
Q. Z. : Oui, complètement. J'avais présenté ce projet à mon ancien éditeur chez Payot et ce n’était pas dans leur ligne éditoriale. Quand j’ai rencontré Élise (Harou, éditrice, NDLR) au Lombard je lui avais montré trois projets dont celui-ci et La Dame blanche. Elle m’a demandé dans quel ordre on allait les faire et c’est moi qui lui ai dit : d’abord La Dame blanche. J’entrais dans une nouvelle maison d’édition et je pense que je voulais montrer un truc un peu plus costaud. Je voulais prouver quelque chose et ne pas arriver avec un « c’est encore une auto-fiction d’un auteur LGBT qui va nous raconter sa petite enfance… » (rires).

Vous n'abordez pas la thématique LGBT de front...
Q. Z. : Non, bien sûr, enfin j'espère ! Il m’a fallu du temps pour mettre en place ce scénario en huis clos. Au départ, je pensais que ça allait être hyper simple mais en fait pas du tout. C’est un vrai cauchemar les huis clos (rires) ! Je m’étais dit « parfait, unité de lieu, unité de temps, tout va rouler comme sur des roulettes »... C'était vraiment un challenge assez costaud, surtout pour la partie scénario, de faire en sorte qu’on comprenne que plein de choses se passent en même temps, au même moment, mais à des endroits différents. Ainsi, les trois personnages principaux ne savent pas ce que fait l’autre. Cam est en train de bronzer pendant que le petit est en train d’essayer d’embrasser son copain dans le jardin pendant que la mère est en train de s’engueuler avec le père dans la cuisine...
Ce sont des endroits différents dans un lieu qui reste très restreint...
Q. Z. : C’est ça. Ce qui m’intéressait, c'était que le lecteur soit omniscient de tout. Il sait tout ce qu’il se passe et se dit : « ohlala mais là les deux petits ne savent pas ce qu’il est en train de se passer avec les parents ». Je trouvais que la tension dramatique marchait bien comme ça. J’ai pris du temps sur le scénario aussi parce que ça fait peur quand on parle de son enfance, notamment pour sa famille. Quand la BD est sortie, j’avais très peur des réactions de ma grande sœur, de ma maman, de mon père… Donc forcément, ça crée de petites tensions qu’on se met tout seul. Le dessin a été réalisé plutôt rapidement mais tout l’avant a été vraiment très long.
Comment avez-vous fait le tri entre la fiction et votre propre parcours personnel ?
Q. Z. : C’est venu assez naturellement. J’ai deux grandes soeurs et un petit frère, mais au moment de l’histoire, quand j’avais sept ans, mon frère n’était pas né ou il venait de naître. Je l’ai donc enlevé mais j’ai mis beaucoup de mon petit frère dans les phrases de Lulu. J'étais un enfant beaucoup plus timide alors que Lulu est un peu casse-cou. Je me suis aussi inspiré des vacheries qu’on s’envoyait quand moi j’étais ado et que lui avait sept ans, l’amour vache quoi. Après, comment on fait le tri, on veut quand-même faire une histoire, il faut que ce soit cohérent. Je me suis imposé les vingt-quatre heures car c'est vachement chiant la vie comme ça, quand on la raconte comme elle s’est vraiment passée. L’autofiction permet de raconter comment on a ressenti les choses et d’amener plus de poésie.
Vous souvenez-vous précisément du jour du décès de Lady Di ?
Q. Z. : Je ne me souviens pas du jour où elle est morte. Je pense que je l’ai appris peut-être à la rentrée à l’école, je ne savais pas qui c’était et je n’y avais jamais fait attention. Par contre, je me souviens très bien de son enterrement, de tous les pleurs du monde entier, de ces foules partout, de la chanson d’Elton John... Je pense que oui, même petit, je me suis dit « waw, c’est impressionnant, c’est ça qu’il se passe quand une princesse meurt », alors que non, ce n’est pas toujours comme ça !
Vous évoquiez tout à l'heure le côté LGBT de l'album alors qu'on y voit surtout l'évolution du sentiment amoureux à travers les âges...
Q. Z. : Je suis ravi de l’entendre (rires) ! Pour moi, le sujet de ce livre était trois désillusions amoureuses à des âges différents, mais surtout l’amour qui lie les trois personnages. Je ne voulais pas faire des grands drames. Ce sont de petits drames de la vie qui font mal mais dont on se sort. Quand on y repense et qu'on en reparle avec ma grande sœur, on se dit que tout s'est finalement bien passé. On avait à cette époque notre amour, nos chamailleries, nos Chocapic le matin, les dessins-animés, maman qui fait des blagues... Comment ça aurait pu aller mal ?
La comparaison entre la mère et la fille est très intéressante : on voit Cam qui est blonde et qui veut se mettre en lumière alors que la maman vit en retrait de sa vie de couple et de sa famille...
Q. Z. : La mère n’est jamais loin derrière, elle est soit dans la cuisine soit avec ses roses dans le jardin, mais oui elle semble plus enfermée que les autres. Je n’y ai pas fait attention du tout, c’est mon petit frère qui me l’a fait remarquer. Il m’a fait également fait remarquer que le feu est très présent dans cette BD, que ce soit la scène avec le dragon ou celle avec le jardin et la maison en flamme. Quand j’avais dix ans et mon frère trois, la maison a brulé. Il m’a envoyé un message pour me dire que l’album lui avait rappelé plein de souvenirs de quand il était petit et aussi l’incendie de la maison alors que je n’y avais pas du tout pensé ! C’est fou l’inconscient !
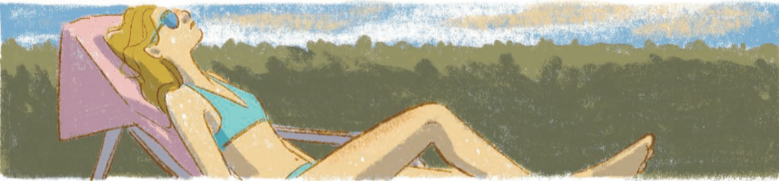
Pourtant, dans la première scène de l'album, c'est l'eau qui est omniprésente…
Q. Z. : Je voulais que l’on ait cette scène avec la chanson de La Belle au bois dormant, ça m’a aidé dans le récit pour revenir en arrière. Cela permettait une approche plus sérieuse au début plutôt que d’arriver d’entrée avec la maison et la radio qui parle de Lady Di. Je voulais que ce soit poétique. Ce sont nos jeux d’enfants, on les a tellement massacrées ces petites poupées...
Même s'il choisit à la fin de les sauver, ses princesses...
Q. Z. : Oui, il les aime. Il s’est rendu compte que ce n’est pas à elles qu’il faut en vouloir, mais aux paparazzi (rires) ! Ce sont eux les grands méchants de l’histoire ! Comme je le disais, ce qui m’intéressait, c'était la féminité. Lulu voit Yoyo comme un petit casse-cou, il fait du foot, il aime bien faire pipi dehors... D’un autre coté, tout ce qu’il comprend de la féminité, ce sont les stéréotypes des poupées. C’est avec Cam et sa maman qu’il va construire sa propre vraie féminité, qui n’est pas une princesse endormie, mais une princesse qui s’éveille.
L'une des poupées avait déjà été martyrisée par Cam...
Q. Z. : J’aimais beaucoup que ce soit presque ritualisé, qu’on se dise que Cam aussi est déjà passée par là avec ces mêmes questionnements de « en fait je ne pourrai pas te ressembler, tu m’envoies un mirage ». Donc ça l’énerve et elle la rase. Dans l'album, je les ai juste noyées mais ce qu’on faisait avec mes grandes sœurs, c’est qu’on les pendait à l’étendoir à linge et on les fouettait avec Ken, c'était encore plus violent (rires).
Est-ce aussi une façon de montrer que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas dupes du fait que les princesses que l’on nous montre à la télé et qu’on voit sur les images, ce n’est pas la vraie vie ?
Q. Z. : Je pense qu’on n’est pas dupes, mais ça n’empêche pas de les aimer et de vouloir s’y identifier. Moi, je voulais être Ariel ou La Belle au bois dormant, je ne voulais pas du tout être Action Man ou GI-Jo, je trouvais leurs enjeux vachement moins bien d’ailleurs. Ils font la guerre pour rien alors qu'Ariel donne son âme au diable par amour, ce qui est beaucoup plus puissant comme projet de vie (rires). Elle le fait par amour pour un homme, c’est beau aussi. On dit aujourd'hui que les Disney, les princesses des contes représentent le mal absolu et que les petites filles pouvaient pas s’identifier à autre chose qu’à des cruches. Mais moi, je ne les ai jamais trouvées cruches ces princesses, elles me fascinaient, elles sont tellement courageuses en fait ! Même si tu attends cent ans dans ton donjon je trouve ça vachement fort (rires), faut avoir de sacrés ovaires.
Cette idée de dérouler le récit sur vingt-quatre heures, vous l’avez eue rapidement ?
Q. Z. : Oui, parce que je pensais que ça allait m’aider, comme je l’ai dit plus tôt, mais en fait non (rires). Je trouvais que ça amenait de la tension, et qu'on allait se demander qu’est-ce qu’il allait se passer après minuit. C’est un peu une tragédie grecque.
Vous parlez de tragédie et l’unité de lieu y participe aussi, on a parfois l’impression d’assister à une pièce de théâtre...
Q. Z. : Les dialogues ont été un petit délice pour moi à écrire. Je voulais vraiment des dialogues du tac au tac et c’est pour ça que j’ai voulu ce duo Lulu-Cam. Je pensais beaucoup à un film que j’adore pendant que je faisais la BD. D’ailleurs, le personnage s’appelle Lulu en hommage à ce film. Il s'agit de L’Effrontée avec Charlotte Gainsbourg. Il y a la petite dans ce film qui s’appelle Lulu, une gamine du quartier hyper malicieuse, qui pose mille questions à la seconde et qui fait chier l’ado. Je voulais créer ce rapport-là entre les deux enfants. Déjà, ça me permettait d’apporter un peu d’humour et je voulais ce Lulu très espiègle, très malicieux, bien plus que je ne l’étais quand j'étais enfant. Je ne posais aucune question, j'étais très timide, j’observais beaucoup. Je lui ai donné les mots que j’aurais aimé avoir. À la fin, quand il va dans le lit de sa grande sœur, ce sont des choses que j’aurais adoré faire mais que je ne me permettais pas. C’est ça qui est beau dans la fiction, c’est qu’on peut se réinventer une fin alternative et heureuse.

L’unité de lieu peut poser souci au niveau du dessin, celui de ne pas le renouveler et de réprésenter constamment les mêmes espaces...
Q. Z. : Vu qu’on est dans l’imaginaire de gamins de huit et dix ans, ça permettait des fantaisies comme la scène avec le dragon, comme cette piscine qui devient infinie... J’ai un peu upgradé la piscine, c'était pas vraiment comme ça ! C'était une piscine gonflable normalement ! On a passé un petit pallier en terme de bourgeoisie (rires). Mais oui, ça me permettait d’aller dans le fantastique plus facilement avec ces jeux d’enfants et j’ai adoré recréer les pièces de la maison. J'étais retourné un peu chez ma maman, j’avais pris plein de photos pour refaire la cuisine, la chambre de ma mère avec ce papier peint très fleuri un peu pastel. Après l’histoire est courte quand-même. Sur trois cents pages, je pense que ça aurait été plus compliqué.
On a l’impression que vous avez travaillé aux crayons et aux pastels. C'est aussi une forme de retour à l’enfance ?
Q. Z. : C’est venu assez naturellement. Déjà, je voulais que ça soit très doux, et je trouve que mes albums d’avant étaient plus aquarellés. Je pense qu’on peut très bien réussir à faire du chaud avec de l’aquarelle mais moi je n’y arrive pas (rires). Cette technique peut-être plus « sèche » me permettait d’avoir ces peaux un peu sablées et je trouvais que ça marchait bien. Quand j'étais petit, je dessinais avec les Crayola. Après, je triche parce que tout est fait à l’iPad.
Ce qui est drôle, c’est qu’on réalise très vite que Cam va cramer, avec ces notes de rouge sur sa peau de plus en plus présentes...
Q. Z. : Ce sont des phrases que j’entendais tout le temps de la part de ma grande sœur qui disait « non mais la crème solaire ça empêche de bronzer ». C'était les années 90, c'était très branché là-dessus, le bronzage, l’époque avec les jeans taille basse, les Spice Girls et compagnie... Il fallait revenir de vacances hyper mat. Je ne l’ai pas mis parce que ça m’est revenu après, mais elle mettait carrément de l’huile d’olive. Je pense aussi qu’elle avait peut-être peur et que, finalement, il fallait qu’elle trouve une solution pour ne pas passer à la casserole le soir.
Ça n’est pas sans rappeler le mythe d’Icare…
Q. Z. : C’est ça, et après, ce que j’aime bien, c’est qu’on puisse se dire que ça lui sert. Elle recrache ce soleil avec humour et panache (rires), et ça lui permet d’échapper à cette nuit. J’aime bien parce que quand la mère lui met la pommade, elle lui dit : « tu vas passer une mauvaise nuit » et j’aime bien distiller des petits dialogues très prophétiques sur la suite. Cette ado était un régal à dessiner et à écrire. Avec ces dialogues, elle me permet de dire plein de choses. Elle est très vache avec Lulu et en même temps elle est très tendre. Le fait qu’elle soit dans une problématique où elle se rend quand-même mieux compte des choses comme avec sa mère me permettait des moments plus temporisés, où elle confie à sa maman qu’elle est amoureuse. Oui, je pense que j’ai bien fait de la mettre (rires), c’est la préférée de tout le monde d’ailleurs !
Pour la bande son de l’album (Françoise Hardy, Gala, Lara Fabian...), ce sont vraiment des chansons que vous écoutiez à l’époque ?
Q. Z. : Oui, le « Je t’aime » de Lara Fabian était à fond dans la chambre de ma sœur. La chanson de Gala était vraiment sortie cette année-là précisément et je ne voulais pas trop qu’il y ait d’anachronismes. Sa traduction collait avec le livre, libérée du désir, je trouvais que ça marchait très bien… Je ne suis pas allé cherché hyper loin pour Françoise Hardy parce que c’est une de mes chansons préférées et vu que la maman est avec ses roses…
Avez-vous trouvé le dessin de la couverture rapidement ?
Q. Z. : C'était mon premier jet. On a tenté ensuite plein d’autres choses, les graphistes trouvaient qu’on ne comprenait pas trop le tee-shirt sur la tête. Il a eu ensuite juste une couronne pour rappeler le titre. Deux semaines avant l’impression, j’ai dit que je voulais le tee-shirt. La couronne, je trouvais ça trop littéral avec le titre. Ce qui permet à mon moi enfant et à ce personnage d’accéder à son statut de princesse et de pouvoir embrasser l’autre, c’est son tee-shirt et pas sa couronne.
Dans tout votre album, on ressent finalement beaucoup de douceur...
Q. Z. : Ce livre a été accompagné d’une chanson que j’écoutais en boucle pendant que j'étais en train de l’écrire, c'était La Tendresse de Marie Laforêt. Elle parle de seigneurs et de princesses, qu’on peut vivre sans richesses mais pas sans tendresse. Je voulais que ce soit un livre qui, malgré ses déceptions et désillusions, parle de tendresse et d’espoir. Il y a toujours un terreau et il se construit dans la tendresse. On sait que pertinemment que ça va bien aller pour eux, que même le divorce des parents est finalement une bénédiction, il fallait que ça se fasse. C’est un conte à l’envers, « ils se séparèrent et vécurent heureux quand-même ». Le père sauve un peu la mère en partant. Je comprends qu'on soit plus « team maman » mais n’empêche, il lui rend le plus grand des services aussi. Elle, elle est complètement dans le mensonge, elle veut continuer ses gratins aux poireaux, elle ne va pas dans la bonne direction. C’est elle qui va possiblement entrainer tout le monde dans le mur si la situation ne change pas. Finalement, le choix du père est bon pour tout le monde.








