 Après la canicule, voici venu le temps de l’orage. Ancré dans la France post « 30 glorieuses », On dirait le Sud est un diptyque dans lequel la tension monte à un rythme soutenu : celui où le soleil chauffe les esprits. Derrière une légèreté apparente, diverses petites histoires se croisent pour former un récit aux enjeux bien humains. Le premier tome, Une piscine pour l’été, avait séduit par son dessin atypique, ses qualités narratives et la densité de ce qui se jouait dedans. Le second tome, La fin des coccinelles, poursuit sur la lancée.
Après la canicule, voici venu le temps de l’orage. Ancré dans la France post « 30 glorieuses », On dirait le Sud est un diptyque dans lequel la tension monte à un rythme soutenu : celui où le soleil chauffe les esprits. Derrière une légèreté apparente, diverses petites histoires se croisent pour former un récit aux enjeux bien humains. Le premier tome, Une piscine pour l’été, avait séduit par son dessin atypique, ses qualités narratives et la densité de ce qui se jouait dedans. Le second tome, La fin des coccinelles, poursuit sur la lancée.Cédric, vous avez notamment fait des études de lettres et de cinéma, On dirait le Sud n’est pas votre premier album, comment vous êtes-vous retrouvés avec Raphaël autour de ce projet ?
Cédric Rassat : Oui, j'ai commencé par des études de Lettres avant de bifurquer vers la fac de ciné, de la Licence au DEA... J'ai aussi été pigiste pour "Rock & Folk" pendant quelques années (de 1998 à 2001). Mon premier contrat de BD, je l'ai signé avec Glénat en 2002. C'était pour Les Cloches de Watertown, le premier William Panama... Raphaël et moi nous sommes rencontrés en 2003 (l'été de la canicule...) par l'intermédiaire d'Emre Orhun (avec qui j'ai fait Erzsebet et La Malédiction du Titanic). À l'époque, Emre et moi venions de présenter un projet qui n'a jamais vu le jour (pour tout un ensemble de bonnes raisons) et qui s'appelait "Clinique Vivaldi". Raphaël venait de terminer Cohl et ne se sentait pas encore prêt pour attaquer la BD. Pourtant, il avait déjà une ébauche d'histoire en tête et nous avons tout de suite commencé à discuter de ce qui allait devenir le récit de On dirait le Sud.
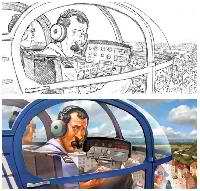 Vous ouvrez votre premier tome sur une scène qui semble directement venir du cinéma, y a-t-il chez vous une envie d’opérer un rapprochement entre cinéma et bande dessinée ?
Vous ouvrez votre premier tome sur une scène qui semble directement venir du cinéma, y a-t-il chez vous une envie d’opérer un rapprochement entre cinéma et bande dessinée ?C.R. : Pas forcément... Enfin, disons que, pour moi, On dirait le Sud, c'est vraiment de la bande dessinée. L'histoire ne pourrait pas fonctionner telle quelle au cinéma ou à la télévision. Il faudrait des modifications... Après, pour en revenir à l'ouverture du récit, ce qui compte c'est la façon dont on va amener les informations. Le début du premier tome, c'est une sorte de western. Il fait chaud, deux types attendent ; un troisième arrive. Sa silhouette se détache de l'horizon, on ne sait pas qui il est ; il dit bonjour. On pense qu'il va devenir le maître du jeu, et puis, finalement, non. Un marché lui est proposé et il se retrouve coincé. En une scène de dialogues, la situation s'est retournée contre lui et le récit s'est installé. C'est, en tout cas, comme ça que je vois cette scène...
Dans cette première scène, un marché est proposé à Max, le délégué syndical ; un marché terrifiant et attrayant. Plus que parvenir à ses fins, c’est la réaction humaine qui semble motiver celui qui tient les clés du marché. Qu’en est-il de celui qui écrit l’histoire ?
C.R. : Oui, je crois que les patrons cherchaient surtout à le faire plier. Ils pouvaient virer n'importe qui et n'avaient certainement pas besoin de la liste de Max. Donc, ce qui les motivait c'était surtout l'idée de corrompre le syndicaliste, de l'obliger à se renier et, donc, de lui faire perdre la face devant les ouvriers. D'un point de vue scénaristique, ce type de marché est forcément intéressant puisqu'il met le personnage principal face à un choix qui implique les valeurs (politiques, morales, familiales) sur lesquelles il a fondé toute sa vie. L'équilibre de Max Plume est fragile et cette période de canicule le fait vaciller.
Le destin de Max Plume était-il scellé quand vous vous êtes lancé dans l’écriture de cet album ?
C.R. : La fin de l'album et les grandes lignes de ce second récit étaient déjà là en 2003, lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette histoire et à écrire les premières séquences d'Une piscine pour l'été. D'ailleurs, ce diptyque était, au départ, envisagé comme un récit unique de 70-80 pages (finalement il y en a 124)... Pour en revenir à Max Plume, disons qu'il fallait bien le faire plonger un peu... Dramatiquement, ce second volet est un peu conçu comme la face sombre du premier (c'est l'intérêt d'un diptyque...). Donc, à partir du moment où Max a récupéré la mallette (cf. la fin de la première partie), il n'y a plus qu'à regarder jusqu'où il va se renier, se compromettre...
Une des spécificités de votre bande dessinée réside dans l’imbrication de nombreuses histoires, légères ou graves, locales ou nationales, qui se font et se défont autour de cette intrigue principale. Qu’avez-vous voulu apporter par ces variations ?
C.R. : Eh bien, déjà, comme je le disais, l'écriture du premier album a commencé très tôt, puisque j'ai écrit les premières scènes très rapidement, dès 2003. Ensuite, comme Raphaël voulait d'abord trouver ses marques dans le milieu de l'illustration, nous avons laissé passer du temps. Trois ans, puisque l'album (avec le scénario complet) a été présenté à Delcourt à la fin de l'été 2006... Pendant ces trois années, d'autres idées sont venues s'ajouter au récit de base et la matière narrative a fini par devenir vraiment très dense. On a quand même une bonne dizaine de personnages principaux et chacun d'entre eux a son histoire, etc. Donc il fallait trouver un équilibre... Ceci dit, c'est vrai que j'aime bien croiser les histoires et jouer sur les dissonances ou les rapprochements que cela peut créer. D'une certaine manière, c'est un peu comme une partition de musique : on joue avec le rythme, la tonalité, etc. Et puis, la vie est un peu comme ça, non ?
On a le sentiment que l'un de vos plaisirs est de décontenancer votre lecteur, je me trompe ?
C.R. : Oui, en fait, je n'aime pas trop cette idée. J'ai un peu joué à ce jeu sur William Panama, avec Guillaume Martinez, mais j'ai vite trouvé ça lassant. C'était trop artificiel. Et assez vain... Pour moi, On dirait le Sud relève d'une logique complètement différente et, à mon avis, bien plus pertinente. Surprendre pour surprendre, ça n'a pas de sens... Ce qui compte, ce sont les personnages, le récit... Pour prendre un exemple de cinéma, vous pouvez être "surpris" par tel ou tel détail d'un film d'Hitchcock, mais ce n'est pas ce qui va vous donner envie de le revoir. Or, si, comme moi, vous pouvez voir et revoir Vertigo ou La Mort aux trousses, c'est avant tout parce que ce sont des récits magnifiquement racontés... Donc ça signifie que le récit et les personnages sont la priorité. D'ailleurs, je crois aussi qu'un scénario n'est jamais vraiment réussi si les personnages ne finissent pas, à un moment ou à un autre, par imposer (au moins en partie) leurs propres règles. Le but est quand même de les faire exister, de leur permettre d'"incarner" le récit... C'est pour ça qu'il faut savoir être très attentif à ce qu'on met en place au début de chaque histoire. Ensuite, il suffit de se laisser guider, tout en veillant à garder le cap... Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question mais, en tout cas, il est clair que je ne cherche pas spécialement à surprendre ou à décontenancer avec On dirait le Sud. Je veux que cette histoire puisse être lue et relue et, pour ça, il faut qu'elle ait du sens...
Vous placez ce récit à la sortie des 30 glorieuses. Que représente cette époque pour vous ?
C.R. : Je pense que les personnages de Max, Sylvia, Claude et Marie sont arrivés à un âge charnière. Ils ont atteint la trentaine et se retrouvent confrontés à de vrais choix d'adulte. Ils ont le sentiment de s'être éloignés de cette jeunesse qui leur aura permis de connaître les grandes manifs de la fin des années soixante et du début des années soixante-dix. Et puis, il y a eu la défaite de 1974... Et mai 1981 est encore loin. Donc je pense qu'ils se retrouvent tous plus ou moins dans une sorte de "temps mort", confrontés à leurs propres idéaux. Ils regardent leur vie et pensent à ce qu'ils avaient rêvé d'en faire... Ils se retrouvent face à leurs choix ; ils les assument ou pas... Mais, pour tous, c'est un peu le moment d'une certaine introspection.
 À l'époque des faits, vous-même deviez avoir un âge approchant celui de Luce, une petite fille qui tient un rôle important dans le récit. Comment avez-vous recréé les décors, l'ambiance de ces temps passés ? Vous êtes-vous documenté, basé sur des souvenirs ou en avez-vous parlé avec vos parents ?
À l'époque des faits, vous-même deviez avoir un âge approchant celui de Luce, une petite fille qui tient un rôle important dans le récit. Comment avez-vous recréé les décors, l'ambiance de ces temps passés ? Vous êtes-vous documenté, basé sur des souvenirs ou en avez-vous parlé avec vos parents ?C.R. : Cet été-là, j'avais cinq ans. Je n'ai pas de souvenirs précis de la canicule. Pour tout vous dire, je ne suis même pas sûr d'avoir été en France au plus fort de la vague de chaleur. Par contre, j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque, et encore plus de mai 1981. Donc je comprends bien ce que l'élection de Mitterrand a pu signifier pour des militants de gauche qui avaient dû "avaler la pilule" (hum...) de 1974. Bien sûr, il va de soi que je me suis servi de toutes ces observations pour composer les personnages de On dirait le Sud... Ensuite, en en parlant autour de moi, j'ai pu trouver quelques pistes intéressantes comme les hélicoptères (qui surveillaient vraiment la consommation d'eau dans certains coins) ou les coccinelles (très présentes, cet été-là)... Et puis, il y a eu les films, et notamment ceux de Claude Sautet ou, pour d'autres raisons (les couleurs, mais aussi la façon d'amener le drame), Le Bonheur d'Agnès Varda.
Raphaël, comment avez-vous abordé cette question de la mise en couleur ?
Raphaël Gauthey : Vous avez raison de signaler l'importance de la couleur, car c'est un élément majeur du récit et vu que je suis au départ plus illustrateur que bédéiste, cela me convenait tout à fait. Néanmoins, j'ai souhaité que l'atmosphère soit pesante malgré l'utilisation de couleurs vives et lumineuses. En saturant et en contrastant les teintes, ainsi qu'en travaillant mes modelés de façon géométrique, j'ai voulu accentuer cette impression de malaise. C'est toute l'ambiguïté et l'intérêt de ce projet : dépeindre un drame en fond alors que la forme montre le contraire.
On peut ressentir à travers votre dessin quelques thèmes important de l’œuvre de Edward Hopper : l’attente, des personnages comme perdus… Qu’en pensez-vous ?
R.G. : On m'a fait la réflexion, après la sortie du premier tome Une piscine pour l'été, qu'il y avait une correspondance entre mon travail et celui de Hopper. J'ai vraiment été flatté, mais en vérité je ne l'avais pas du tout remarqué, même si j'adore ses peintures. Concernant la langueur des personnages, tout ça est d'abord inhérent au scénario. C'est l'été, et surtout la canicule, qui les assomme et qui va faire monter la pression.
Cédric, pour revenir à Luce, avez-vous voulu lui donner un rôle particulier, notamment concernant le regard qu'elle porte sur ce qui se passe autour d'elle ?
C.R. : Luce est intéressante parce qu'en plus d'être la seule enfant du récit, elle a un problème de vue. Donc le regard qu'elle pose sur le monde qui l'entoure et, donc, sur les autres personnages est forcément décalé. Bien sûr, elle amène aussi une certaine innocence, mais c'est vraiment son regard qui m'intéresse le plus. Personnellement, j'aime beaucoup la scène du chien dans le premier album : les deux adultes ont une conversation à laquelle on ne comprend pas grand-chose, mais elle regarde ailleurs et son regard fait complètement dévier la scène.
Il y a un personnage, Claude, qui n'est pas sans faire penser au capitaine Stilman par sa façon d'être, sa manière d'appréhender les évènements avec un flegme total, presque agaçant. A priori, vous avez décidé de le bouger un peu dans ce deuxième tome ?
C.R. : Le personnage de Claude est entouré de beaucoup de non-dits. À première vue, on pourrait penser que son embourgeoisement relatif et l'évolution de ses idées politiques (cf. le début du premier tome) l'opposent à Max, mais on s'aperçoit vite que la réalité est plus complexe... Ce que je trouve intéressant dans ce personnage, c'est qu'il se révèle vraiment au contact de la petite fille. Au début, il ne sait pas trop comment lui parler et puis, finalement, on s'aperçoit que c'est presque avec elle qu'il est le plus à l'aise. Leur complicité est encore plus développée dans La Fin des coccinelles, je trouve... Après, ce personnage est aussi construit sur de grandes zones d'ombre. Que fait-il dans la vie ? On ne le sait pas. Pourquoi lui et Marie n'ont-ils pas d'enfants ? On ne le sait pas non plus. Or, ces zones d'ombre finissent par prendre plus d'importance dans cette seconde partie, comme si le personnage était rattrapé par une partie de ses démons. Pour moi, c'était inévitable... Il subit, lui aussi, le contrecoup de cette chaleur étouffante.
Les deux sœurs de votre histoire sont très différentes, qu'avez-vous voulu faire passer ?
C.R. : Sylvia et Marie ont effectivement des personnalités différentes. La première a l'air un peu perdue. Elle a l'impression d'être un peu isolée et semble davantage portée vers l'introspection. A l'inverse, Marie semble plus superficielle et peut-être plus égocentrique. Mais je pense qu'elle est surtout plus forte... En tout cas, elle ne se laisse pas dépasser par sa propre vie. Concernant leur opposition, je n'ai rien cherché de particulier. Je trouvais intéressant qu'elles aient un rapport différent à leur père, à leurs souvenirs et à leur propre vie. Les sœurs ou les frères se construisent généralement en s'appuyant sur leurs différences. En tout cas, c'est mon avis...
Cédric, vous semblez avoir une vision très précise, très pensée, du rendu que vous souhaitez voir apparaître sur la planche. Comment avez-vous travaillé avec Raphaël ?
C.R. : Quand j'ai écrit le premier album, je n'avais quasiment pas la moindre idée de ce à quoi pourraient ressembler les planches de Raphaël. Tout ce que je connaissais de son travail, c'était quelques peintures, dont celles qu'il a réalisées pour un livre sur Frida Kahlo. Autant dire qu'on était loin de On dirait le Sud... Seulement, je savais aussi qu'il était très méticuleux et vraiment impliqué dans le projet. Donc je lui faisais confiance... Depuis quelques années, mes scénarios présentent toujours un découpage assez précis. Ça me permet de mieux souligner mes intentions au dessinateur. Ensuite, libre à lui de se réapproprier le découpage... Pour Une piscine pour l'été, Raphaël avait vraiment simplifié mon découpage. Il l'avait rendu plus clair, plus aéré... L'écriture de La Fin des coccinelles a été différente pour moi, car j'avais les planches du premier album en tête. Donc je savais ce qu'il était capable de réaliser, je connaissais les points forts de son dessin, etc. Pour ce scénario, mon découpage était plus simple et, finalement, assez proche de celui des planches d'Une piscine pour l'été. Mais, dans le même temps (rappelons qu'il s'est écoulé trois ans entre les deux albums), Raphaël avait aussi affiné sa réflexion sur la mise en scène et le découpage, et je crois que nous sommes parvenus à une forme narrative encore plus aérée et limpide...
 Enfin, j'aurais apprécié avoir votre avis, tout en le mettant en perspective sur On dirait le Sud avec sur cette phrase de Jean-Marc Pontier (dans Nicolas De Crécy - Périodes graphiques) : "On ne choisit pas d'illustrer un texte s'il n'y a pas un tant soit peu d'adhésion au fond du propos".
Enfin, j'aurais apprécié avoir votre avis, tout en le mettant en perspective sur On dirait le Sud avec sur cette phrase de Jean-Marc Pontier (dans Nicolas De Crécy - Périodes graphiques) : "On ne choisit pas d'illustrer un texte s'il n'y a pas un tant soit peu d'adhésion au fond du propos".C.R. : Je pense qu'il y a une incompréhension, là... Raphaël n'a pas "illustré" un texte ; nous avons vraiment réalisé ce projet ensemble, moi au scénario et lui au dessin... Cette histoire, on en a discuté dès notre première rencontre, en 2003. Raphaël avait un projet embryonnaire qu'il voulait situer dans la région du Creusot, d'où est originaire une partie de sa famille. Il avait aussi envie d'évoquer le milieu ouvrier à travers une sorte de chronique familiale. Les personnages du grand-père et de la petite fille faisaient aussi partie de ses intentions. Comme l'action devait tourner autour d'une usine, j'ai pensé qu'il serait bien de centrer l'intrigue sur un personnage de syndicaliste (qui, par définition, est toujours pris entre deux camps : celui des ouvriers et celui de la direction). Ensuite, la canicule (l'été 2003 était particulièrement chaud) nous a fait penser à l'été 1976... Ce qui m'a amené à penser à l'affaire Ranucci et, donc, à la peine de mort. De fil en aiguille, la peine de mort m'a fait penser à l'élection de Mitterrand, et donc à la génération de nos parents, etc. Voilà, tout ça pour vous dire que On dirait le Sud est vraiment un projet commun, dans lequel nous trouvons tous les deux notre compte. Vous savez, nous réfléchissons et discutons beaucoup avant de nous lancer dans chaque nouveau projet. Par exemple, pour notre prochain album, qui sera un polar situé dans les années 60, nous discutons et échangeons depuis plusieurs années déjà (j'ai le titre et l'idée de ce projet depuis 2008). Et je viens à peine de commencer à l'écrire... Plus globalement, je crois que nous avons tous les deux l'ambition de réaliser des albums qui puissent être lus et relus. Nous mettons beaucoup de temps à faire émerger chacun de nos projets, donc nous tenons vraiment à ce que ce temps investi puisse déboucher sur quelque chose de réellement significatif. Je pense que La Fin des coccinelles nous permet d'aller au bout de ce que nous cherchions à réaliser avec On dirait le Sud. L'album pose un éclairage différent sur les personnages, ainsi que sur les enjeux dramatiques et politiques du récit. Et je pense qu'il correspond bien à ce que nous recherchons.





