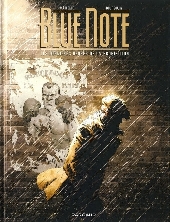Qu'est-ce qu'une couverture réussie ? Sans doute celle qui attire le regard parmi le flot régulier des nouvelles parutions, celle qui parvient à résumer en une image le contenu de l'histoire ou celle qui procure l'envie irrésistible de se saisir de l'album pour en découvrir le contenu. Celle de Giant est un peu tout ça à la fois : un homme au bord du vide contemple une ville qu'on imagine volontiers être New York, ses vêtements rappelant le début du 20e siècle. Il est alors temps de commencer la lecture et de se plonger dans un récit passionnant dont l'épilogue est déjà prévu pour le début de l'année prochaine.
Quelle a été l’idée première du récit ? La construction du Rockefeller Center ou l’immigration des Irlandais à New York au début du 20e siècle ?
Mikaël : La première idée a été de raconter une histoire sur New York, une ville qui me fascine depuis bien longtemps. J’avais quelques ébauches de scénario mais je ne parvenais pas à trouver le bon angle pour aborder les thèmes qui me tenaient à cœur. Puis, je suis tombé en 2012 sur la photo « Lunch atop a Skyscraper » et j’ai décidé de raconter l’histoire des immigrants. Étant moi-même aussi un immigrant, j’avais envie de parler d’expatriation. Je suis donc parti de cette photo qui a été prise en 1932 sur le Rockefeller Center alors en construction. Les éléments sont venus au fur et à mesure, sur la base d’une chronique humaine avec en toile de fond la Grande Dépression. Puis sont venus également les thèmes de résilience, de l’enfermement que l’on a souvent dans les grandes villes en ayant l’impression de passer à côté de sa vie quand le rythme du « métro-boulot-dodo » s’installe. Derrière la grande Histoire, je souhaitais aussi parler de celle des petites gens et que mon récit puisse résonner dans le contemporain. Aujourd’hui encore, des personnes laissent leur famille dans leur pays d’origine pour aller vivre dans des baraquements pour gagner de l’argent et en envoyer le maximum à leurs proches.

M. : Oui. À l’époque, la guerre civile en Irlande était officiellement terminée mais il y avait encore des répercussions.
Ici pourtant, il ne s’agit pas de familles mais souvent d’un père qui laisse femmes et enfants de l’autre côté de l’Atlantique…
M. : Certains émigraient en famille, mais souvent le mari partait seul et la famille essayait ensuite de le rejoindre s’ils avaient de quoi payer la traversée. Avant les années vingt, seul le billet de bateau était à payer, tandis qu’ensuite d’autres formalités ont été mises en place, ce qui revenait assez cher. C’est une histoire finalement très contemporaine et universelle. On entend aujourd’hui que les immigrés n’apportent rien dans le pays dans lequel ils arrivent, ce qui n’est absolument pas le cas. Même si les grands buildings à New York ont été commandités par de riches familles, ce sont quand même eux qui les ont construits.
Même si vos conditions d’expatriés n’ont pas grand-chose à voir avec celles des Irlandais au début du 20e siècle, avez-vous trouvé quelques résonances dans le fait de laisser son pays d’origine loin derrière soi ?
M. : Même quand il s’agit d’un pays occidental, et même si les différentes culturelles peuvent paraître minces, partir est en soi un exil. Ce qui est aussi intéressant, c’est de se confronter aux fausses idées que l’on peut se faire d’un pays. Par exemple, on disait au début du 20e siècle que les rues aux États-Unis étaient pavées d’or. D’après les témoignages que j’ai pu retrouver, les immigrants se rendaient compte en arrivant que les rues n’étaient pas pavées du tout et que c’était à eux de les faire ! (sourire) Le fait de se réinventer dans un pays qui n’est pas le sien demande un effort et quand on ne l’a pas vraiment vécu, on a du mal à se rendre compte de ce que c’est. Je parle des codes humains, des rythmes de vie… Ce n’est pas une nouvelle vie puisqu’on ne fait pas table rase de tout le reste, c’est juste la vie qui continue mais d’une autre manière. Aux États-Unis comme à Montréal, les communautés se retrouvent entre elles et s’entraident, chose qu’on ne voit pas par contre pour la communauté française…
Giant, comme les buildings, est un géant qui se construit…
M. : Ce que j’aime dans les histoires, c’est qu’il y ait suffisamment de place pour que le lecteur puisse s’y projeter. Depuis que l’album est sorti, j’ai eu beaucoup de retours et chacun y a mis une part de soi en fonction de son passé. C’est aussi pour ça que j’ai inséré des doubles pages muettes pour que chacun puisse interpréter à sa façon. Giant est un personnage qui vit un deuil, on sait qu’il a subi un traumatisme en Irlande. En arrivant à New York, il s’est enfermé dans un quotidien. Le fait qu’il n’ait pas cette forme mentale pour s’en sortir obligeait à ce qu’il possède une force physique démesurée. Il y avait aussi ce genre de personnage dans Des hommes sans loi joué par Tom Hardy qui était l’un des trois frères qui faisait de la contrebande pendant la Prohibition. Il n’était pas aussi grand que Giant mais il était un peu taciturne, ne parlait pas beaucoup, était un peu immortel puisqu’il avait survécu miraculeusement à la Première Guerre Mondiale. Le côté peu bavard de Giant fait qu’on a envie d’en savoir plus sur ce personnage. D’ailleurs, il est pris en photo par une photographe qui s’intéresse à lui. J’aurais pu mettre un ’s’ à Giant, il représente les buildings et toutes ces petites gens qui sont aussi des géants à leur façon.
Une double page évoque également le temps qui passe et le caractère presque routinier des travailleurs…
M. : Exactement. J’ai réalisé le plan dans lequel les enfants reçoivent la lettre trois fois, avec trois scènes différentes. Les deux planches évoquent un aller-retour permanent entre New York et l’Irlande. Je mets beaucoup d’importance dans la composition de l’image mais aussi dans celle de la page, l’enchaînement du passage de l’œil et la fluidité d’une case à l’autre. Je travaille aussi souvent en double page avec notamment un jeu sur les pots d’encre qui se remplissent et se vident d’une page à l’autre.
Les paroles semblent glisser sur Giant, il est par contre bouleversé par une lettre qu’il reçoit…
M. : Inconsciemment, il voit dans cette lettre une petite porte ouverte pour essayer de se sortir de cette solitude. C’est finalement la rencontre de deux solitudes : elle dont le mari n’écrit plus depuis des mois et lui qui s’est enfermé dans son quotidien. Giant est souvent proche du vide, peut-être que ça l’arrangerait s’il glissait, n’ayant jamais eu le courage de franchir le pas.

M. : Ce n’est ni un mauvais bougre ni un ours acariâtre qui n’aime personne. On voit aussi que c’est quelqu’un qui a refusé la violence.
Il semble par contre apprécier le cinéma… muet !
M. : Je voulais jouer là-dessus. Le cinéma muet lui va très bien, comme il ne parle jamais. Chaplin aussi est un clin d’œil, c’est finalement quelqu’un qui se fait aussi passer pour quelqu’un d’autre : Giant ne signe jamais ses lettres, contrairement à Maria à qui il écrit.
Il y a également moins de tendresse dans ses lettres que dans celles de Maria…
M. : Oui, même si les formules de politesse à la fin évoluent petit à petit.
La voix off de Walter Winchell est-elle idéale pour mettre le lecteur dans l’ambiance ?
M. : J’aurais pu m’en passer. Mais je me suis aperçu que lorsqu’on va à New York, il y a une véritable frénésie d’informations, il y a beaucoup de monde, Times Square est quasiment épileptique… Le récit de Giant commence tranquillement en apercevant le lieu où habitent les personnages. J’ai voulu y rajouter de l’info pour retrouver ce que je ressens chaque fois que je me rends là-bas. Quelque part, c’est aussi un peu le narrateur. Quand Walter Winchell dit « mes chers auditeurs », c’est un peu moi qui dis « mes chers lecteurs ». (sourire)
Si la photo « Lunch atop a Skrypaper » a été le point de départ du récit, quelles ont été les autres sources de documentation ?
M. : J’ai acheté beaucoup de livres, puis les photos que l’on peut trouver sur internet. J’ai aussi consulté de nombreux documentaires et lu des romans sur cette époque, dont certains sur la construction pour savoir comment se passait la paie. Les ouvriers se mettaient alors en rang et un gars venait tous les vendredi directement sur le chantier avec une valise remplie d’argent avec deux policiers à ses côtés. Habitant près de New York, j’ai aussi pu y aller et accéder aux archives photos du Rockefeller Center qui ne sont pas accessibles au public. Je me suis également rendu à la New York Public Library où j’ai pu avoir accès à des grands négatifs en celluloïd. Même si c’est une fiction, j’ai essayé d’être le plus vraisemblable possible.
Les couleurs sépia de New York évoquent également les cartes postales vieillies...
M. : C’était aussi pour jouer sur la différence urbain-campagne, les couleurs de l’Irlande tendant vers le vert. Comme j'ai beaucoup travaillé sur des photos en noir et blanc et en sépia, j’ai eu l’impression que toute la ville avait ces couleurs. (sourire) Les couleurs flashies de Baz Luhrmann dans Gatsby passaient très bien car le film était explosif. Je me suis que si j’avais utilisé ces couleurs, cela aurait desservi mon histoire. D’un autre côté, mon encrage est assez présent pour se suffire à lui-même. Les couleurs sont là pour amener juste une petite touche supplémentaire d’ambiance, sans être aussi effacées que dans Promise. La couleur est aussi narrative puisque j’ai utilisé un jaune un peu plus saturé pour les bruits forts.
La couverture est particulièrement réussie...
M. : C’est juste dommage que le sticker soit mal placé mais on ne pouvait pas retourner tous les albums pour ça. (sourire) J’ai réalisé ce visuel en 2014 pour la présentation aux éditeurs en plus de cinq pages. L’éditeur m’a avoué plus tard que c’est ce visuel qui l’avait marqué, plus que le reste. (sourire) Quand on a commencé à parler de couverture, j’ai fait plusieurs propositions, mais il a finalement souhaité que j’utilise ce premier visuel. J’ai juste changé les couleurs pour y mettre un orangé-brun et un ciel blanc avec un peu de texture. C’est aussi une couverture à laquelle on peut donner beaucoup d’interprétations comme celle de Giant qui contemple le vide de sa vie.
Celle du tome deux est déjà présente en quatrième de couverture...
M. : Oui, le deuxième tome est prévu pour sortir à Angoulême 2018. J’avais fait trois propositions : une avec la Statue de La Liberté, une avec juste la Skyline et une avec le pont de Brooklyn, cette dernière ayant été retenue.
Promise se déroulait également aux États-Unis, un simple hasard ?

M : Non. Déjà, je préfère travailler sur une base historique qui procure plus de recul que sur une histoire contemporaine. Puis j’habite en Amérique du Nord donc j’ai déjà quelques accointances... (sourire) Je prépare un nouveau diptyque qui évoque le New York des années trente, c’est l'histoire de quelqu’un qui se trouve sur le front en Allemagne pendant la deuxième Guerre Mondiale et qui se remémore son passé de cireur de chaussures. Et si ça fonctionne bien, peut-être un autre diptyque qui suit également ce fil rouge du New York des années trente.
Revenir sur des albums jeunesse, c’est d’actualité ?
M. : J’en ai fait plus d’une douzaine. Depuis qu’on m’a proposé le scénario de Promise, j’essaie de tout mettre à plat pour me trouver une identité graphique adulte. Pour l’instant, j’ai trop de plaisir à faire ça pour retourner vers le secteur jeunesse.