A
u cœur d’une mégalopole tentaculaire en perpétuelle mutation, où le rythme de la nature a depuis longtemps cédé sous les coups de la symphonie dissonante du béton, Guillaume Trouillard orchestre un drame écologique, une œuvre chorale en un seul acte. Dans l’orgueilleuse Babel, l’homme ne fait que figurer, un court instant. Il n’est que cette marionnette qui s’agite dans le grand théâtre de l’absurde. Au fil de l’inextricable enchevêtrement des voies de circulation, les individus se croisent, se heurtent, se blessent et meurent dans l’indifférence et la solitude. Et ce qu’il subsiste de la faune et de la flore confine à l’abstraction, à moins d'être purement et simplement envoyé au rebut parmi ces vieilleries sans valeur dont la modernité n’a que faire.
Véritable pamphlet, réquisitoire féroce à l’encontre du capitalisme effréné, des vicissitudes de la société de consommation, Colibri instruit avant tout à charge. Dans un exutoire aussi frénétique que jouissif, Trouillard dénonce, pêle-mêle et sans souci de nuance, la déforestation, le matraquage publicitaire vantant les plaisirs superflus, le culte hygiéniste de l’apparence, le sabir jargonnant des experts – celui des juristes et des yuppies. Il désigne dans un même élan à la vindicte la cupidité des promoteurs immobiliers, la vacuité des discours, l’arrogance des nantis, les délires techno-scientifiques, mais aussi le tourisme voyeuriste de la misère et les dérives liberticides du tout-sécuritaire. À vouloir domestiquer une nature prétendument hostile, à se couper de ses racines, l’homme, dans son aveuglement, s’est créé une jungle bien plus menaçante. Et l’auteur de s’en prendre, dans une fresque engagée, au droit de propriété, au contrat social comme facteur d’aliénation, d’un asservissement volontaire et librement consenti au Léviathan. Derrière l’enfermement, se dévoilent subrepticement la nostalgie d’un paradis perdu, une "ode aux peuples premiers", à ce bon sauvage dont les derniers vestiges subsistent à peine, à l’instar de ces indigènes clochardisés mendiant une maigre pitance.
En contrepoint de ce tourbillon fiévreux, vorace et suicidaire, font écho la luxuriance et l’explosion de couleurs. L’utilisation virevoltante et tourmentée de l’aquarelle comme de l’encre soutient à merveille la démonstration, celle de la confusion d’un monde désormais privé de repères et courant à sa perte. En épigraphe, le proverbe des indiens Cree résonne rétrospectivement d’une force toute prophétique : "Seulement quand le dernier arbre aura été coupé, quand le dernier fleuve aura été empoisonné, quand le dernier poisson aura été attrapé ; alors seulement vous verrez que l’argent ne peut pas être mangé".
Ce manifeste poétique donne aussi l’occasion de découvrir un éditeur encore confidentiel, les Editions de la Cerise, dont la prometteuse revue Clafoutis laissait – déjà – présager du meilleur.
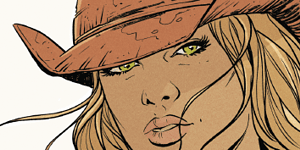












Si je devais décerner un prix à Colibri, cela serait celui de la stupéfaction. En effet, je ne comprends pas comment une telle oeuvre a pu susciter tant l'éloge notamment le prix bd 2008 des lecteurs du journal de gauche Libération. Je n'invente rien car un sticker l'annonçant était collé fièrement à la couverture.
Une telle lecture dans un genre de déambulation onirique ne m'a rien apporté que de l'ennui. Cela part dans tous les sens au point de ne ressentir que de la stérilité voire de l'austérité. Certes, il y a cette critique du capitalisme et de la société de consommation mais dans laquelle je ne me reconnais pas. Graphiquement, ce n'est pas mon style. Tout est dit.